« Pour écrire ces lignes, je suis obligée de me charcuter un peu au fer rouge ; sans une once de courage, je serre les dents et les paupières, je hurle avant d’avoir mal. Plus j’avance dans la chair du passé plus me brûle le cœur », nous dit le « je » de Danièle Saint-Bois, dont le style protéiforme nous plonge en incandescence – le souffle coupé.
La mort d’un amour puissant et dévastateur peut provoquer diverses réactions, surtout lorsqu’il fut, dans une jeunesse déjà lointaine, « ce tremblement qui vous prend les entrailles, cet éclair de désir qui vous zèbre le corps, vous sabre, vous enveloppe, vous agenouille, vous crucifie, vous emporte » mais aussi « vous exalte, vous exécute, vous détruit ».
Ici, dans Trois amours de ma jeunesse, la narratrice apprend par téléphone « un soir de mai 2015 » que « Mia est morte. Oui. Bon. Inutile d’insister, je ne souffre pas ».
Mais alors de quoi s’agit-il ?
Celle qui parle, « vieille pomme dans [son] lit devant [sa] télé allumée », décrit pourtant un « afflux de sang au cœur » à l’annonce de la nouvelle, avec aussi « des larmes plein les yeux », et « un grand vide » qui se glisse en elle pour « remplacer tout de [sa] chair, de [ses] os, de [ses] organes ». Elle flotte, hésitante sur ce qu’elle sait encore – ou pas – du passé et qui « cependant stagne » en elle comme « une eau croupie qu’il faudra bien écoper, écoper jusqu’à la mince pellicule qui finira par s’évaporer pour qu’enfin apparaisse le précieux sédiment ».
Voilà nous y sommes. Et en effet le livre de Danièle Saint-Bois nous donne à voir, ou plutôt à absorber bouche bée, ce « précieux sédiment » que vient révéler la mort de cet incommensurable amour que fut Mia – connue à l’âge de 17 printemps (alors que la narratrice a 26 ans, un mari et plusieurs enfants). « Elle est entrée en moi d’un coup, sans effort, sans autorisation », nous est-il expliqué, « elle a rongé mes muscles, mon cerveau, mon foie, mes reins ». Sans parler du séisme familial. « Mia m’a tuée. Elle ne l’a pas fait exprès. Je plaide l’acquittement », lisons-nous encore, alors qu’une vie se détricote ou s’éparpille là sous nos yeux écarquillés, et que nous tirons, nous lectrices et lecteurs, les mêmes fils entortillés, les mêmes débris d’une existence cabossée de toutes parts.

« La vie n’est que strates empilées d’amours et de désamours, d’amour et de silence. » Ainsi, de la disparition de Mia surgissent Frankie et Linda, autres attachements qui ponctuèrent fortement l’adolescence puis la jeunesse de la narratrice, le monde dont elle est issue et qu’elle qualifie de « sous-classe sans chauffage, sans eau chaude, sans frigo, sans godasses, sans espoir, cette classe des plus pauvres que pauvres qui bizarrement votaient à droite parce que des cocos, on en connaissait qui étaient pleins aux as, qui s’étaient enrichis pendant la guerre ».
Frankie (et « son assurance, sa beauté, sa joie de vivre, son espièglerie ») fascine la narratrice, qui se sent « comme asphyxiée par la notion de différence de classe, de misère », mais lui inflige simultanément « les pires tourments que l’amour secret fait endurer ».
Linda est une relation « platonique, irréelle » – « on échangeait des lettres et des baisers furtifs, de coins de bouche », alors que : « Mon alliance brillait à mon doigt. »
Le mystère ne sera pas dévoilé ici du développement de ces Trois amours de ma jeunesse – précipitez-vous sur le livre pour en savoir plus, et vous ne le regretterez pas, foi de Roffinella !
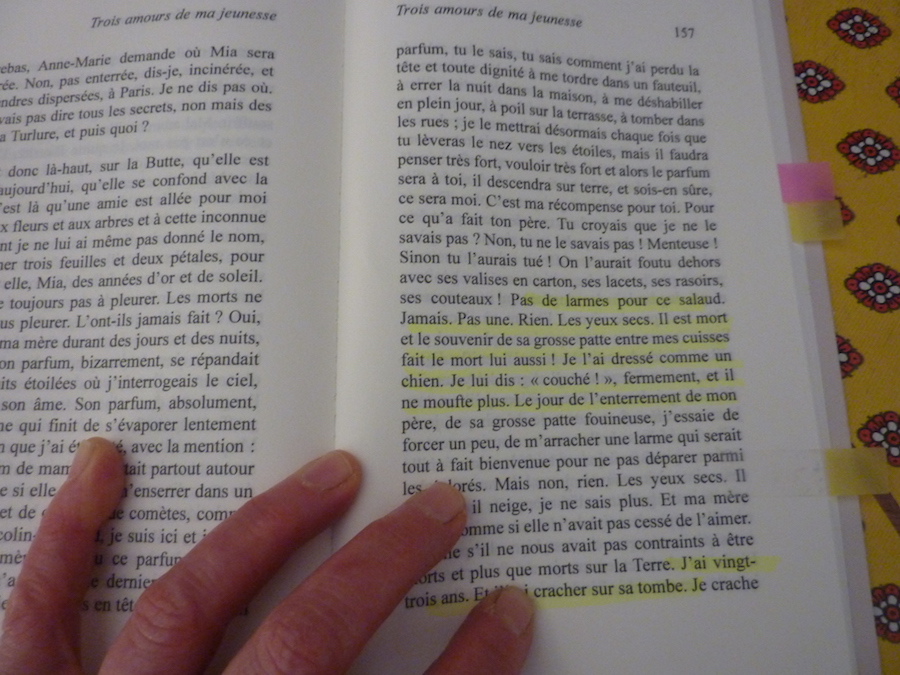 Quatre questions à Danièle Saint-Bois
Quatre questions à Danièle Saint-Bois
MARTINE ROFFINELLA : Votre conception de l’autofiction est de toute évidence très personnelle – puisque l’intitulé « roman » figure sur la couverture de votre livre. Pourriez-vous nous expliquer, s’agissant d’un texte à la première personne, quelle est votre position en tant qu’écrivaine face au déroulement des faits ?
DANIÈLE SAINT-BOIS : Dans la mesure où l’histoire racontée ici à la première personne est mon histoire ou tout au moins une partie, le noyau incandescent de ma vie, il ne s’agit évidemment pas d’un roman à proprement parler, cependant, dès que l’on écrit son histoire, on en fait autre chose qu’un récit autobiographique, on la romance ne serait-ce que par la mise en pôle position de certains événements. Je parle d’autofiction dans la mesure où les souvenirs, qui sont le moteur, les rouages du récit, sans être gravés dans le marbre ni dans un cerveau qui n’a pas tout imprimé et qui a beaucoup oublié, se trouvent parfois incertains, flous, réinventés peut-être ; je m’autorise à écrire ce qui vient, comme ça vient, sans rechercher l’exactitude dans le temps, la vérité dans les attitudes, les dialogues, les comportements ; par exemple, ici, j’avance que Mia et moi n’avons jamais dépassé le stade du baiser mais qu’en était-il réellement, je lève les paumes vers le ciel, je les regarde comme si j’avais la faculté de lire le passé dans les lignes de ma main et je dis : je ne sais pas. Je ne sais plus. Je cherche et je ne trouve pas. J’auto–fictionne en quelque sorte tout en restant persuadée que ce que j’avance est juste l’écume d’une réalité disparue. Je m’efforce maintenant d’aller au plus près de l’os, là où ça fait mal. Sans masque.
M. R. : Comment avez-vous construit la trame de votre récit ? La mort de Mia a-t-elle été l’élément déclencheur permettant une reconstitution voire une identification des liens entre les différents événements ? Aviez-vous toute la toile de vos souvenirs en tête ou bien les histoires ont-elles surgi au fur et à mesure de votre avancée en écriture ?
D. S.-B. : Au début de l’écriture d’un livre je ne me pose aucune question de construction, de forme ; pas de plan, pas de chapitres, pas de début, et en général pas de fin surtout lorsqu’il s’agit d’un vrai roman ; j’ai toujours un problème avec la fin, je sais rarement comment l’histoire va finir, sauf bien entendu dans le cas de ce récit dont l’élément déclencheur en effet a été l’annonce de la mort de Mia.
Mon premier roman publié, Galápagos, Galápagos, (éditions Stock, 1979), racontait déjà l’histoire de Mia, sans doute très différemment, écrite en quelque sorte sur des cendres encore fumantes. Les deux autres amours de ma jeunesse étaient là, aussi, dans ces pages assez explosives. Je me suis bien gardée de remettre le nez là-dedans. Le livre que je décidai d’écrire, en un instant, pratiquement sans réflexion, le soir de l’annonce de la mort de Mia, serait la recherche dans ma mémoire et dans mon corps d’un amour dévastateur, alors que la jeunesse s’est irrémédiablement enfuie.
J’ai écrit quatre lignes qui sont au début du livre, pouvant faire office d’introduction et de conclusion : « Où donc s’en vont les amours qui nous ont mis les tripes en feu ? Dans quel gouffre ont-ils – elles – sombré ? Qui sommes-nous aujourd’hui, nous qui avons tant aimé ? » J’ai laissé poser comme de la pâte à crêpes.
Quelques jours plus tard j’ai écrit la première phrase : Les cendres de Mia ont été éparpillées dans un jardin montmartrois qui porte un nom étrange que j’ai déjà oublié, et tout a suivi, je savais que le livre était là tout entier, un peu vague et informe mais il m’habitait, il n’y avait plus qu’à le cracher, l’expulser, je pourrais même dire le vomir pour en finir avec toutes ces douleurs qui ont bien rempli ma vie, je l’avoue.
Je ne savais pas trop où j’allais, la seule certitude c’était que cette sorte de recherche archéologique dans le sous-sol de mes jeunes années n’allait pas me faire que du bien. C’était un peu comme si je n’en finissais pas d’ouvrir des boîtes ou des poupées russes, de l’une naissait la suivante. Comme si Mia et Linda étaient nées de Frankie, et dans le livre Frankie et Linda de Mia. Un petit article sur le livre dans Point de Vue avait d’ailleurs titré : « Boîte de Pandore. » Un fil tiré en amenait un autre automatiquement. Et ça, cette façon d’écrire, d’emprunter plusieurs routes, ça ne se décrète pas, ça ne se prépare pas, ça s’élabore au fur et à mesure dans l’innocence la plus totale, et pourtant dans un ordre que le cerveau a sans doute préparé en douce.
M. R. : De quelle façon ressort-on de pareille exploration intime ? Et d’ailleurs, comment y entre-t-on ? Existe-t-il une porte dérobée ou une fenêtre qui permette d’y voir clair sur soi et sur sa propre vie de manière aussi stupéfiante qu’authentique ?
D. S.-B. : On ressort épuisé d’une telle introspection, soulagé dans un premier temps, puis malheureux. Oui, c’est après que le malheur re–commence. Quand on a expulsé le trop-plein de tout ce qui vous a tenu dans un état de frustration douloureuse et qu’on se retrouve avec la preuve qu’on a tout fait à l’envers.
Quand j’écris, je ne suis jamais consciente de ce que je fais, comment je le fais, c’est comme si ce n’était pas moi ou alors un moi, une moi innocente de toute arrière-pensée, une moi habitée par un mystère qui me fait explorer les routes et les chemins de traverse de l’écriture un peu comme si j’écrivais sous influence mais de qui, de quoi ? J’ai de plus la certitude que depuis le début, j’écris toujours le même livre, sous toutes les formes possibles et imaginables, le même livre depuis toujours. Depuis mes premières publications, et même mes non publications, j’exécute des variations sur le même thème, j’ai peur, parfois, de me répéter.
Ici, la porte dérobée pour tenter de démêler enfin l’écheveau d’une existence « cabossée » est celle par où Mia est sortie. Je me suis engouffrée dans la faille car j’avais quelque chose de plus à dire, je devais enfin mettre des mots sur ma bombe à retardement personnelle, dire simplement l’intime, longtemps occulté. C’est pourquoi ce livre est celui que j’attendais de moi. Celui dans lequel explose mon secret, enfin expulsé de ma tête.
M. R. : Concernant plus précisément votre style, à la fois si singulier et protéiforme – percutant comme une colère ou un cri, haletant comme une confidence faite en urgence, et poétique dans sa résonance au monde et dans sa restitution écorchée des émotions –, pourriez-vous nous expliquer ici votre façon de travailler ? Remettez-vous « cent fois sur le métier votre ouvrage », ou bien jaillit-il quasiment tel quel ?
D. S.-B. : Je prends souvent l’exemple de la mayonnaise pour expliquer et m’expliquer à moi-même comment de l’idée de départ, des premiers mots, d’une phrase souvent banale – comme par exemple la première phrase de mon prochain livre à paraître chez Julliard sans doute en octobre : « Ceux du premier, gauche, ont apporté des frites, des vraies, c’est ce qu’ils ont prétendu… » – va naître un livre.
Donc j’ai le jaune d’œuf, c’est bien, c’est un bon début, c’est trois lignes ou dix, ou, miracle, une page. Je regarde un peu la consistance du jaune, j’ajoute la moutarde entre les lignes, entre les mots, du sel, du poivre, j’émulsionne, j’ai trois pages, voyons à quoi ça ressemble, où ça me mène… c’est le moment de mettre de l’huile, un filet, j’émulsionne, et là si la mayonnaise prend, je continue, j’ajoute de l’huile, mais toujours en repartant de la première phrase. Une fois la mayonnaise montée, le travail commence. Avec les doutes, les questionnements, le pourquoi du comment, les à quoi bon ? Je retourne vers le jaune de l’œuf, oui il était frais, la moutarde, le sel, le poivre, et ça recommence. En route pour la version deux.
Au bout de quatre ou cinq versions avec des retraits, des ajouts, des déplacements de paragraphes, de chapitres, c’est presque fini. Mais jamais complètement. Ça prend du temps. Et ce n’est jamais parfait. Mais tant pis. Les livres parfaits seront écrits par des intelligences artificielles. Ils s’adresseront à des intelligences superficielles qui comprendront tout cependant.
Mon style, c’est ce qui plaît ou qui heurte, je ne fais pas dans la demi-mesure, je ne peux pas, je fonce, je n’ai pas le temps de conter fleurette dans la sobriété ; la ligne droite ce n’est pas pour moi, je ne peux pas, je n’ai pas envie de me perdre dans des joliesses, de m’enfermer dans un cadre susceptible de plaire au plus grand nombre. De toute façon, étant très timide, j’aime bien provoquer, la provocation n’est pas mon but, c’est comme l’humour ça vient tout seul, on l’a ou on ne l’a pas. Ce serait trop bête de brider l’animal.
Bizarrement ce que j’écris plaît davantage aux hommes qu’aux femmes qui se sentent agressées. Je me souviens que lors de la sortie de Marguerite, Françoise et moi (Julliard, 2009), de jeunes blogueuses avaient été choquées par la couverture, alors vous pouvez imaginer les réactions au contenu. Parfois je me dis que je fais de l’art brut parce que je suis moi-même à l’état brut et que je n’ai jamais eu envie de sauter dans l’état de grâce…

Trois amours de ma jeunesse, roman, par Danièle Saint-Bois, aux éditions Julliard, 18 euros.
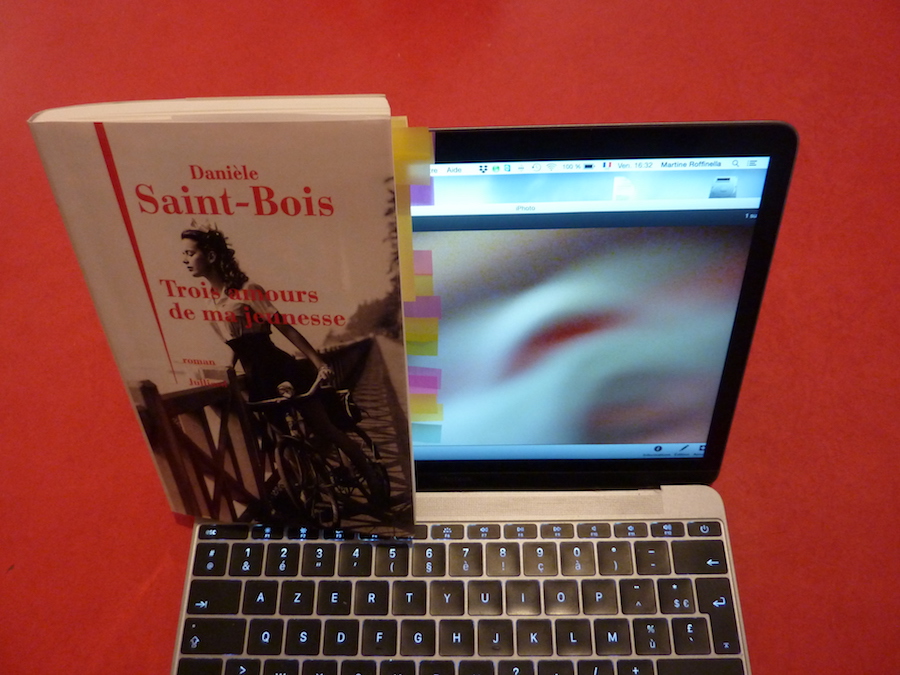
Il n’y a pas d’alternative. Après lecture de ce bel article, on ne peut que commander le livre… Merci pour ce travail et pour tes propositions de lecture…