Nous sommes dans un roman d’anticipation, et pourtant l’affaire qui nous y cloître paraît se dérouler au moment même où elle surgit derrière un mur de diamant expansé. « Prisonniers dedans, prisonniers dehors » ? La Grande Catastrophe est à deux pas.
C’est une époque où il n’est pas choquant d’abandonner ses propres enfants au bord de l’autoroute, quand on est « bien embarrassé d’eux » pendant les vacances. « Un bébé sage, ça s’oublie sur une banquette arrière, pendant le trajet », mais « durant les cours de rafting ou de deltaplane, que voulez-vous en faire ? ».
Les « orphelinats touristiques » sont « de plus en plus appréciés » – et celui que nous nous apprêtons à découvrir est un établissement « construit voici plus d’un siècle, sur les anciens volcans d’Auvergne, auprès du lac Pavin ». Les orphelins y sont « parqués comme des réfugiés dans un camp, comme des déchets dans un dépotoir, loin des villes, loin des plaisirs, loin des tentations ».
Mais voilà. Par une de ces pirouettes dont le Destin (certes un brin manipulé) a seul le secret, ces enfants dont les parents ont voulu « oublier l’existence » vont être sauvés de la Grande Catastrophe : la « mer d’amertume qui, peu à peu, s’est étendue sur toute la planète ».
Pourquoi ? Comment ? Impossible de vous le révéler ici sans trahir tout l’art du suspense que manie admirablement Jean Claude Bologne !
Sachez tout de même que la folie des hommes et leur « compétition permanente » dans tous les domaines ont fait se « renverser » le monde.
La « matière » elle-même s’est mise de la partie, vers une « croissance » jugée « infinie », vers « des records à battre à tout prix » et se multipliant de façon monstrueuse.
« Prolifération anarchique des cellules », « grand cancer de la matière dans l’emballement du monde » : l’eau amère s’est étendue sur toute la planète, engloutissant les villes et partant à l’assaut des montagnes.
Une eau « acide dans laquelle toute vie s’est dissoute avant même qu’on ait le courage de se noyer ».

Un seul endroit échappe à la Grande Catastrophe, miraculeusement (ou plutôt scientifiquement) protégé par un mur de diamant expansé : l’orphelinat et ses laissés pour compte.
La vitre est indestructible. Des gens, à l’extérieur, viennent ici se noyer dans un ultime espoir, agrippés à la paroi, « lambeaux de chair, orbites vides, mâchoires décrochées ».
Le mur est bien étanche, et le monde « s’effrite » autour des orphelins, les cadavres s’accumulent contre cette cloison de diamant, « le bas rongé d’acide, le haut livré aux corbeaux, à tous les stades de putréfaction » : « C’est instructif, de voir ce qu’il y a à l’intérieur d’un homme. On comprend mieux où frapper pour faire mal. »
Le roman nous place quinze ans après la Grande Catastrophe.
La communauté de rescapés (les « emmurés de diamant ») est organisée de façon à éviter toute « fixation sur le passé ». Les enfants ont été éduqués avec « l’obéissance dans le sang ». Ils savent « compter, chasser au boomerang, allumer du feu, faire des enfants » – mais pas lire, car « les livres abîment la mémoire et ébrèchent la docilité ».
À la tête de la communauté (et détenant notamment le secret de l’accès à l’eau potable) : Orsant. Wersant, lui, est chargé de la « discipline » (« Orsant et Wersant passent leur temps à se contredire, mais le préfet de la discipline a l’âme molle et cède toujours le premier »). Mersant le Taciturne apprend aux orphelins « les rudiments nécessaires à la survie ».
Il y a aussi Seuranne la domestique, Seurolga l’infirmière, et le Consistoire, entre autres gardien du « Texte » et ayant soin « de ne pas transmettre le savoir interdit ».

Les lect.rices.eurs se régaleront de la minutie avec laquelle Jean Claude Bologne installe cette société emmurée par le diamant, occasion de visiter remarquablement nos fonctionnements actuels, rendant d’une effroyable réalité ce qui se produit – au point de devoir se pincer pour s’éveiller de cet avenir en marche, où la nourriture se résume aux corbeaux noirs attrapés par les enfants à la chasse.
Des assassinats y sont soudain perpétrés, le passé se dénoue peu à peu, nous devenons vite très proches de Maurine et de Laurent, personnages centraux du livre qui nous tiennent en haleine jusqu’aux derniers mots (lesquels ne m’ont personnellement pas rassurée !).
Quant au corbeau blanc dont l’âme résonne dans tout l’ouvrage, je vous invite, non sans quelque insistance, à faire sa connaissance sur-le-champ. Car qui sait s’il n’a pas votre propre secret à vous révéler ?
Quatre questions à Jean Claude Bologne
MARTINE ROFFINELLA : Pourriez-vous nous raconter de quelle façon l’idée de cet ouvrage a pris corps dans votre imaginaire de romancier, et pourquoi le genre du « roman d’anticipation » vous est-il apparu comme son meilleur écrin ?
JEAN CLAUDE BOLOGNE : J’aime détourner les genres littéraires : j’ai pratiqué à ma manière le roman policier, le roman historique, le roman érotique… Je n’avais pas encore essayé le roman d’anticipation. Or nous vivons depuis une vingtaine d’années une transformation de nos sociétés dans tous les domaines qui donne envie d’en projeter l’évolution dans un futur que j’espère lointain.
Bien sûr, on peut suivre ces transformations dans l’écologie, la politique, les rapports sociaux… Mais elles sont peut-être plus engagées dans la culture que dans les autres domaines, et nous risquons avec beaucoup plus de certitude de connaître l’apocalypse culturelle avant la « Grande Catastrophe » écologique annoncée.
L’apocalypse pouvant d’ailleurs être comprise comme une destruction (ignorance, abandon, destruction ou remise en cause volontaire du patrimoine culturel) ou comme une révélation, un « dévoilement », au sens propre du terme (accès à une autre culture, numérique, virtuelle, fantastique, mondialiste). Cette coupure entre deux univers culturels me semble dangereuse.
Dans mon roman, la maîtrise du « Texte », le récit fondateur et mythique, donc de l’imaginaire par lequel se structure une société, est une arme de pouvoir. De même que la maîtrise de l’écriture (interdite aux enfants) et celle de l’enseignement. Le dessin transmet sans s’en douter des informations qui donneront la clé de l’énigme. Des messages apparus sur le mur de diamant expansé révèlent un autre monde, non seulement physique, mais spirituel (le mot « Dieu », banni, y reparaît), psychologique (que traduisent ces messages ?), moral (le seul fait de les cacher fait naître le mensonge dans un monde transparent). C’est de cette image que l’idée du livre est partie : des mots tracés sur un mur, à l’envers, qui bouleversent la conception du monde.
M. R. : De quelle façon avez-vous procédé pour vous documenter d’un point de vue scientifique – car tout se tient admirablement dans votre récit, et c’est précisément ce qui fait froid dans le dos…
J. C. B. : Un autre point de départ de ce roman a été la découverte d’un petit guide de survie dans un bac de livres d’occasion. On se dit d’abord que ça peut toujours servir pour se débrouiller en cas de catastrophe : trouver sa nourriture, purifier son eau, identifier les dangers… Puis on est effrayé, non par la possibilité de la catastrophe, mais par le piège de la survie. Le survivalisme est à la mode aux États-Unis. Mais quel plaisir peut-on trouver à s’entraîner à manquer de tout durant toute une vie pour survivre un jour dans un abri nucléaire coupé du monde ? La survie devient l’inverse de la vie, je n’en voudrais à aucun prix !
Ce livre a été à la source de précisions techniques, par exemple la construction d’un puits solaire, mais aussi d’une réflexion sur l’inanité de la survie. Quel espoir reste-t-il à ce petit groupe enfermé derrière un mur ? Sont-ils rescapés ou prisonniers ? Puis il a fallu trouver le lieu. En cherchant un endroit où l’eau pouvait ne pas avoir été (trop) contaminée, j’ai découvert par Internet le lac Pavin, dont le système hydrographique est très particulier et qui m’a inspiré le système de régulation grâce auquel Orsant maintient son pouvoir : la gestion de l’eau sera sans doute un atout majeur dans les années qui vont suivre. L’eau amère m’a été inspirée par l’acidification des océans, dont on parlait beaucoup voici une demi-douzaine d’années quand j’ai conçu ce roman.
Ce sont des articles et des reportages qui m’ont alerté sur la diminution du pH des océans, mais les effets en seront lents, et il me fallait une « catastrophe » plus brutale. J’ai alors repensé aux craintes qui circulaient dans ma jeunesse autour de l’eau lourde, dont on croyait, à tort, qu’elle serait capable de convertir en elle-même la totalité des eaux de la planète ! Je me suis aussi intéressé à l’impression en 3D, à partir de laquelle j’ai imaginé la multiplication de la matière.
Mais la toute première version de ce roman, où j’essayais de tout expliquer scientifiquement, était illisible… et en fin de compte peu vraisemblable, puisque le roman ne se passe pas aujourd’hui. Je devais plutôt me mettre dans la peau de savants qui vivront dans quelques siècles avec d’autres possibilités techniques. J’ai donc ôté une bonne partie des explications complexes au profit de termes qui ne correspondent pas à des connaissances actuelles, mais à des découvertes plausibles dans trois ou quatre cents ans. Il ne faut donc pas trop craindre pour un futur proche la contamination macromoléculaire ni la duplication exponentielle… Mais les éléments sont là pour les inventer un jour et il me paraît important d’imaginer, par la fiction, les conséquences possibles et les rapports de force que tout cela va induire entre les hommes.
M. R. : En quoi la thématique des orphelins vous tenait-elle spécialement à cœur, autant d’un point de vue social qu’humain ? Qu’ils soient les survivants de l’ancien monde est-il porteur d’un espoir/message spécifique ?
J. C. B. : Dans toutes les cultures, l’orphelin, l’enfant exposé, le fils d’une vierge… tous ceux, en gros, qui sont en rupture avec leur passé, sont les fondateurs. Le mythe de Moïse jeté dans un couffin sur le Nil est le même que celui de Sargon d’Agadé ou que Romulus et Remus. Le mythe de Jésus né d’une vierge se retrouve dans celui de Bouddha ou de Pythagore. C’est une réflexion ancienne chez moi, née de l’idéologie du bâtard chez Gide et nourrie des recherches d’Otto Rank sur la naissance du héros. Le mythe est séduisant, mais cela ne fonctionne pas de la même manière dans la réalité.
Dans mon roman, c’est l’idéal d’Orsant, qui entend créer une société nouvelle avec des âmes vierges de toute influence. Il se heurte d’une part à d’autres adultes qui entendent rebâtir le monde ancien avec ses traditions religieuses et ses droits de propriété, et d’autre part aux jeunes, curieux de ce qui leur a été ôté, soucieux de leurs racines, et qui reproduisent sans le savoir des schémas culturels ou sociaux révolus. L’intérêt pour moi est de faire s’opposer ces mentalités, de voir en quoi elles sont ou non compatibles, sur quels points vont se cristalliser les rébellions.
Pour des orphelins, qui sont en fait des enfants abandonnés, les rapports de parenté semblent n’avoir aucun sens, et pourtant, s’il y a un espoir de retrouver leur père, ils s’y accrochent, mus à la fois par le désir de reconnaissance et la haine d’avoir été abandonnés. Pour ceux qui n’ont pas connu l’ancien monde, les titres de propriété, qu’ils ne savent pas lire, n’ont aucune valeur, mais ils ont la curiosité des messages dessinés qui leur semblent destinés… C’est pour cela que j’ai laissé agir mes personnages selon leur caractère et selon les événements sans tenter de théoriser leurs réactions.
M. R. : Vous abordez dans cet ouvrage un personnage qui revient souvent dans votre œuvre : Dieu, banni dans la communauté de rescapés, « gros mot qu’il ne faut pas employer » – mais aussi « le dernier espoir quand il n’y avait plus rien à espérer, la dernière réponse quand les questions se heurtaient à un mur ». Pourriez-vous nous en dire plus sur votre approche ?
J. C. B. : Pour l’athée que je suis (mais je sais que je partage en grande partie cette approche avec certains mystiques chrétiens), le mot « Dieu », ainsi que toutes les manifestations, incarnations, représentations iconiques ou mentales qu’il suscite, est effectivement un « gros mot » : je me suis amusé à en faire un juron banni du nouveau monde, mais cela va plus loin pour moi. C’est un obstacle à la quête spirituelle, à toute question existentielle, dont il constitue la réponse toute prête. La réponse est la mort de la question, et c’est la question qui nous fait avancer : c’est ce que j’ai tenté d’exprimer dans des livres précédents, Le mysticisme athée ou Une mystique sans Dieu.
En même temps, une grande partie de la vie spirituelle de l’humanité, depuis ses origines, s’est focalisée autour de ce mot, et le médiéviste, en moi, s’est nourri davantage de maître Eckhart ou de Marguerite Porete que du Roman de Renart ou des Cent nouvelles nouvelles… Je ne peux pas faire l’économie de toute cette histoire, et mes personnages non plus. Plusieurs de mes romans posent effectivement la question d’une manière ou d’une autre, parce que seule la fiction me permet de donner une réponse provisoire.
Le concept de Dieu est comme un appel d’air dans lequel nous nous engouffrons pour échapper à une conception purement matérialiste de notre existence. Mais un appel d’air est une dépression atmosphérique : du vide qui attire le vent. Le Dieu Néant de maître Eckhart me parle plus que le bon-papa à barbe blanche.
Pour mes personnages, le rapport à Dieu est multiple. Orsant ne peut oublier que la Grande Catastrophe a été causée par des terroristes au nom de Dieu, c’est pour cela qu’il bannit le mot et toute forme de religion. Mais ce n’est pas tenable. Les sœurs de ce qui avait été, avant la Grande Catastrophe, un orphelinat religieux, ne peuvent abandonner leur foi patrimoniale. Laurent, élevé dans l’ignorance de toute forme de religion, ne peut se détacher du mot « Dieu » apparu à l’extérieur du mur dans lequel il est enfermé et dont il ne connaît pas la signification. Toutes ces attitudes sont légitimes, mais entraînent des malentendus autour d’un même mot.
L’âme du corbeau blanc, Jean Claude Bologne, éditions maelstrÖm reEvolution, 18 euros.
Retrouvez Jean Claude Bologne sur son site.
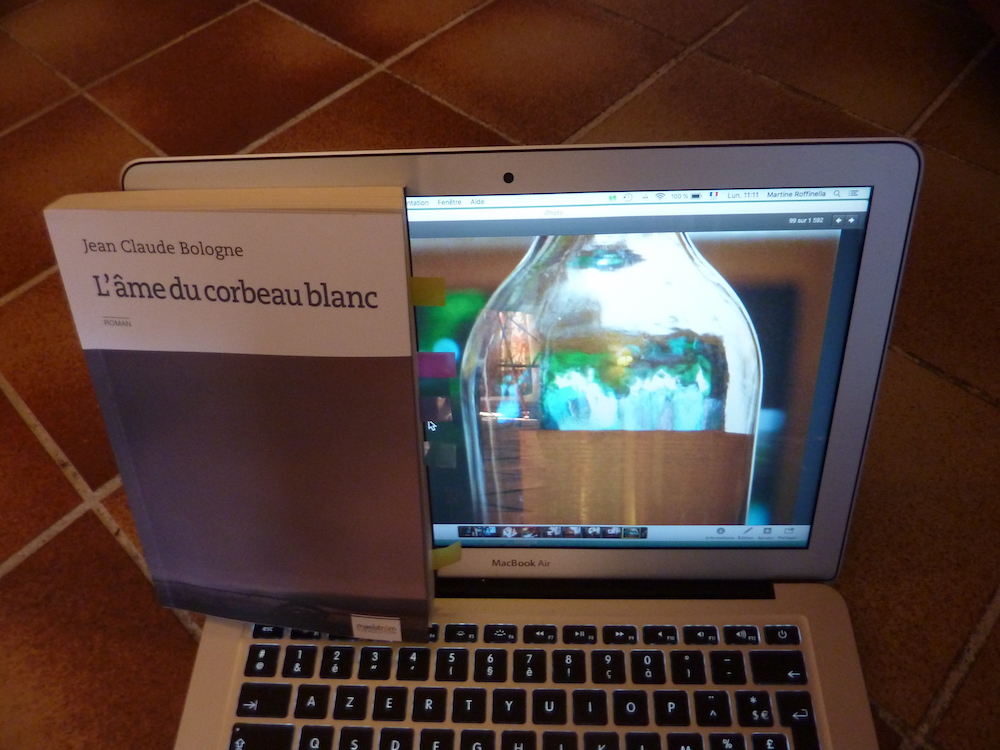

Merci infiniment, chère Martine, pour cette excellente présentation d’un roman formidable (au sens premier du mot : redoutable) qui ne cesse de me hanter depuis que je l’ai lu. Jean Claude Bologne a ce pouvoir terrible de créer des images mentales comme autant d’antidotes à la médiocratie ambiante ; si « la réponse est la mort de la question », la fiction est une renaissance perpétuelle, autrement dit un espoir — telle une aigrette de pissenlit qu’un simple souffle envole au vent (et là, je pense au dictionnaire Larousse de mon enfance !)
J’avoue ne pas être trop friande des romans d’anticipation en général mais à travers ce que je lis dans cette présentation, mon appétit est aiguisé. Force est de reconnaître que les germes de ce possible futur sont déjà là.