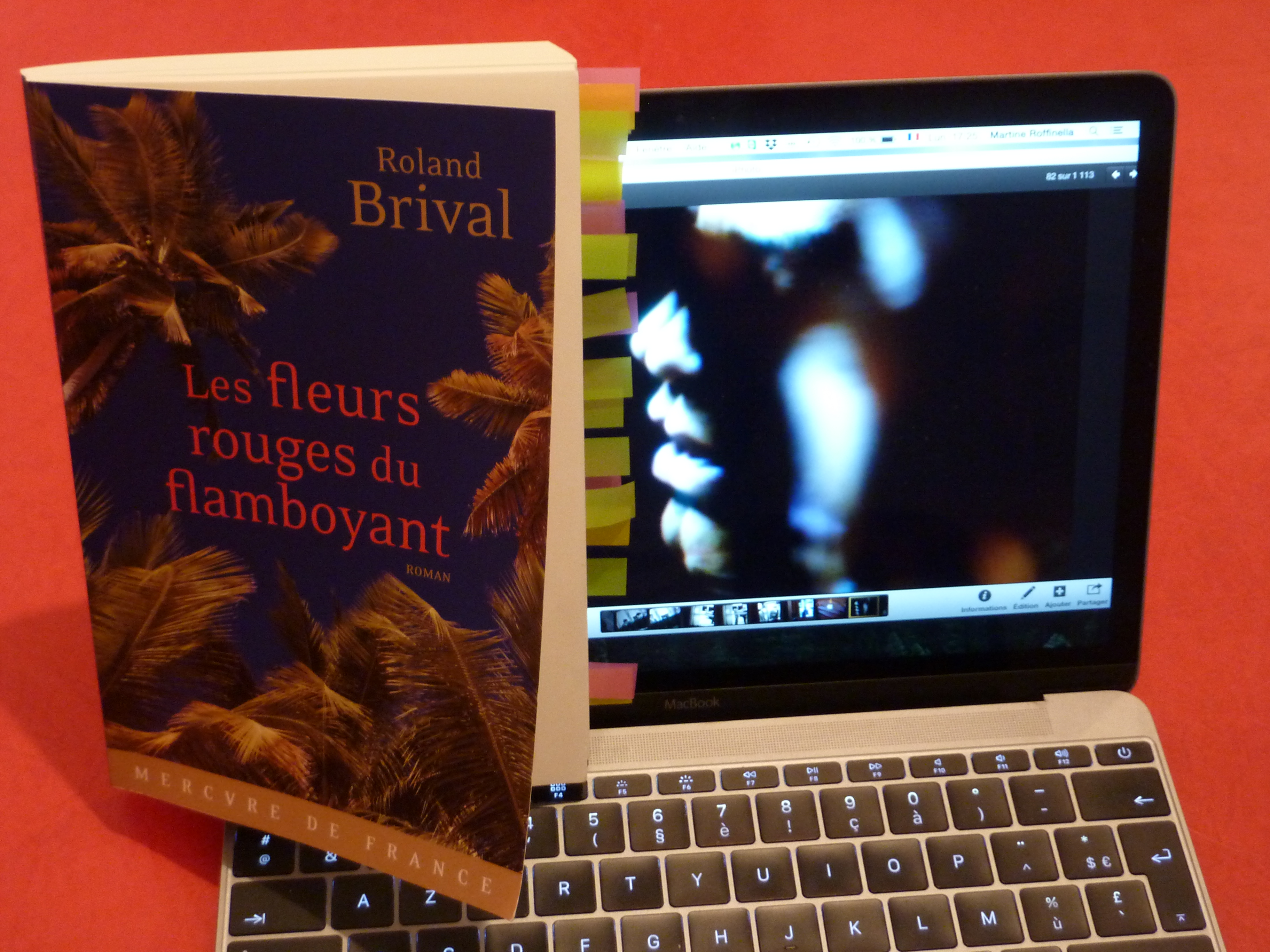« Tout exil est à jamais définitif » : c’est l’intuition qui « nargue » le narrateur des Fleurs rouges du flamboyant, alors que, après des « années d’absence », il retourne dans sa Martinique natale. Mais « à quoi bon revenir sur les lieux » d’un « ancien naufrage » ? Ne vaut-il pas mieux, comme le suggère le dicton, « laisser dormir les pierres au fond de la rivière » ? En quête d’un enchantement peut-être rompu, autant que de racines résolument mystérieuses, Simon, écrivain de son état, nous partage sa traversée de vie, entre « sanglots d’enfant » atemporels et silencieuses « cendres du passé ». Roland Brival est son passeur.
Le roman est à la première personne mais c’est Simon qui parle. Comme Roland Brival, il est martiniquais. Mais là s’arrête tout point de comparaison, car, nous est-il formellement précisé : « Ce sont les personnages qui sont martiniquais. Pas moi, au moment où je prends ma plume ! Si le même roman avait été écrit par un auteur parisien de la Rive Gauche, le liriez-vous de la même manière ? »
Qu’on se le dise donc en s’immergeant dans ce texte métaphorique, en évitant, ainsi que nous le conseille l’auteur, de le « ranger dans la catégorie exotique ».
Au commencement il y a un mystère qui entoure la venue au monde du narrateur, né d’une mère qui n’a « que dix-sept ans à l’époque », et d’un père dont nul ne lui fera « avouer » le nom, malgré le « scandale » qui « entachait désormais la réputation de la famille ».
Nous faisons ainsi connaissance des figures qui entoureront Simon, en dehors de la relation fusionnelle qu’il nouera avec sa mère. Il y a Pa’ Raphaël, son grand-père au caractère trempé, Man’ Elmire, la « seule à pouvoir sécher [ses] larmes d’une simple caresse de la main » et qui a des « pouvoirs de magicienne » (« à cause d’histoires de diablesses et de sorciers » qu’elle raconte « avec le plus grand sérieux »). Voici également Paulette, que « la perspective de traverser un champ d’épines » n’effraie pas, car elle a « la plante des pieds aussi dure qu’une semelle de cuir », et qui se révèle d’une « surprenante agilité » pour faire dégringoler des arbres : goyaves, « mangues-Julie » (bassignac, mangotines, zéphyrines… il en existe plus d’une dizaine de variétés !), cerises ou prunes de Cythère. Sans oublier les oncles et leur partie de dominos « à la lueur des étoiles ». L’oncle Georges, « colosse au teint d’ébène », l’oncle Fulbert, « sorte de sosie d’Omar Sharif », l’oncle José et l’oncle Émile qui, « à cause de leur peau claire », se vantent « d’appartenir à la catégorie des mulâtres », l’oncle Antoine, qui arbore « les traits d’un Indien caraïbe », et aussi l’oncle Jérôme parti pour la guerre d’Algérie au nom de « Papa-De-Gaulle » (dont Simon imagine « naïvement » qu’il fait « partie de la famille ») et qui ne guérira pas de cet « enfer », cette « sauvagerie ».
Nous suivons le petit Simon habité par l’écrivain devenu adulte, et qui s’aventure à pas hésitants sur la falaise de ses souvenirs. La Martinique nous est offerte avec majesté, à la fois dans les yeux de l’enfant et dans l’émotion du narrateur qui revit les séquences l’âme à vif. Certains endroits sont demeurés intacts, comme le quartier de Volga-Plage, sur les hauteurs de Fort-de-France, avec ses « cases misérables entassées à flanc de colline », les « gosses en haillons qui jouent sur le trottoir », les « vieillards mélancoliques », les « femmes aux allures résignées qui descendent vers la ville, leur panier sur la tête », etc. D’autres n’ont plus rien à voir avec ce que Simon a connu dans ses jeunes années, « le pays » a bien changé : « la Martinique des doudous, des colliers choux et des foulards madras, c’est fini », les embouteillages de l’autoroute font qu’« on se croirait tous les matins à Tokyo », « tous condamnés à bouffer des légumes au chlordécone » – « c’est ça, les Antilles d’aujourd’hui ! ». Malgré les « saveurs anciennes » (clou de girofle, beurre de roucou, feuilles de bois d’Inde, oignons-pays, etc.) qui « explosent » toujours au palais du narrateur, l’écrivain Simon, qui nourrissait le « vague projet » d’un « retour définitif dans l’île », vacille. Au gré de son séjour, « cette Martinique d’antan » qu’il est venu chercher « s’effrite en miettes » sous ses yeux.
Mais qu’est-il donc venu chercher sur sa terre natale ?
« Attendre papa, c’était comme guetter l’arrivée d’un fantôme dont vous saviez qu’il ne se montrerait jamais […] C’était comme jouer à faire semblant d’être en vie. Mais ce n’était pas la vie. »
Simon est « le bâtard de la famille », qui sera contraint, dans des circonstances à jamais douloureuses, de rejoindre sa mère partie à Paris pour gagner sa vie – dans cette « France dont elle avait rêvé » et qui n’existe pas, ce Paris qui ne « ressemblait en rien à cette ville de lumières qu’elle imaginait rivale d’Hollywood et où l’on croisait cinéastes et producteurs à tous les coins de rue ».
Cette mère qu’il retrouve après une longue séparation n’est alors plus qu’une de ces « figurantes de l’ombre dont les silhouettes s’entassaient tous les jours dans les wagons deuxième classe de la RATP ». Immeuble de banlieue, minuscule réduit avec toilettes « sur le palier ». Et comme le chauffage électrique coûte trop cher, elle allume la cuisinière à gaz la nuit.
De tout cela, Simon se remémore alors qu’il est en Martinique – avec ce double regard d’ici et de là-bas, conscient d’avoir été pour sa mère « le prince qu’elle idolâtrait », mais aussi cet « explorateur improbable égaré dans une jungle de béton » dont il ne connaît pas les codes.
Elle lui restera une « femme inconnue », malgré leur vie commune rocambolesque et un lien fusionnel – inévitablement déçu, peut-être…
Trouver le père, ce grand inconnu, serait-il donc le moyen d’enfin savoir « à quel monde » appartient Simon ?
« Tu es né en Martinique, et c’est le sang vert de ce pays qui coule dans tes veines. C’est là ta seule richesse, comprends-tu ? Tu n’as rien d’autre à offrir au monde que ce que nous t’avons donné », lui martèle-t-on dans sa famille. Il lui faut donc découvrir le « véritable reflet » de son âme. Et cette quête passe par de fortes (et tragiques) retrouvailles avec Évanyse, grand amour de jeunesse abandonné alors qu’elle est enceinte de lui : Simon reproduit-il un schéma dont il a lui-même souffert ? – « tapie dans l’ombre, se tenait la silhouette de mon père, ce père coupable de m’avoir abandonné, ce père aveugle et absent dont je m’apprêtais, par une cinglante ironie du sort, à suivre les traces ».
Mais, alors qu’il veut « poursuivre la farandole de ses souvenirs » et s’imaginer encore « dans la peau du gamin » qu’il fut, Simon s’aperçoit qu’Évanyse est « le puits sans fond où tourbillonnent les derniers remous de [son] enfance antillaise ».
Le mystère de la naissance de Simon sera-t-il, au bout du compte, résolu ?
Évanyse, à qui le narrateur confie « les ultimes mots d’amour de [son] être insulaire », saura-t-elle le réconcilier avec son « impossible terre d’élection » ?
Lisez le roman de Roland Brival et vous obtiendrez la réponse, même si, comme le dit si bien l’oncle Georges, « l’homme ne sait rien de ce qu’il voudrait savoir à propos de lui-même », car nous sommes « des yoles livrées sans capitaine aux caprices de la mer ».
Les fleurs rouges du flamboyant, Roland Brival, éditions Mercure de France, 18,80 euros.