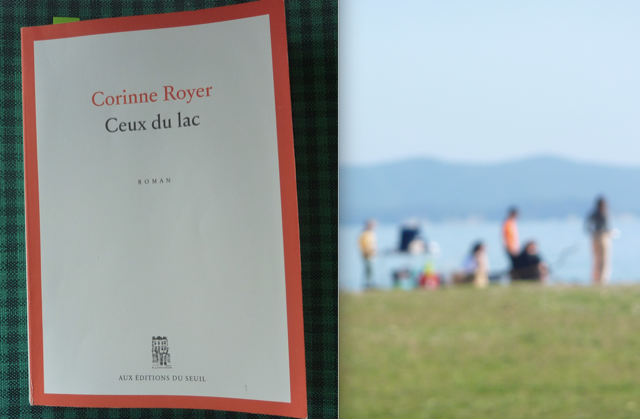Je dois la découverte de Ceux du lac à Augustin Trapenard, qui m’avait jadis invitée sur France Culture, et dont je suis régulièrement le travail aux manettes de La Grande Librairie. C’est lors d’un récent numéro de cette émission que j’ai été fortement impressionnée par l’écrivaine Corinne Royer, dans sa façon d’évoquer son travail et surtout dans l’authenticité de son approche, qui pour moi a crevé l’écran. Je me suis aussitôt dit qu’il faudrait en parler sur le blog Sous le pavé la plume – et je remercie bien chaleureusement les Éditions du Seuil de m’avoir pour cela adressé l’ouvrage.
Corinne Royer, c’est un sujet puissant (controversé pour certains, perturbant pour tous) au service d’une écriture hors normes, qui sait se jouer de tous les styles, ou plutôt emprunter à chacun, pour inventer une vraie narration qu’aucune intelligence artificielle ne pourra copier. Il y a du corps ; il y a de la poésie ; il y a de la violence ; il y a des rites ; il y a des légendes ; il y a les moments happés aux siècles derniers ; il y a l’impuissance aveugle du futur ; il y a les remous assassins du présent ; il y a des personnages sculptés dans le vrai qui vous emportent aux larmes ; il y a la colère et la culpabilité qui vous suffoquent – et il y a le talent pour modeler tout cela dans une histoire dont on ne revient pas, au sens propre comme au figuré.

Nous sommes en 2014. Aux abords du lac et des marécages de Văcărești, en périphérie de Bucarest en Roumanie, vit la communauté des Șerban – des Tsiganes installés là « à l’abri de la fureur urbaine ». Ils sont sept ; le père, veuf, élève seul ses six enfants : l’aîné Sasho, dix-sept ans (surnommé Sash – « Sash, celui qui sait ! »), puis « les Șerban du milieu » Marcus, quinze ans, et Ruben, quatorze ans, ensuite les jumeaux Aki et Zoran, douze ans – et enfin la seule fille, Naya, presque dix ans, qui a « vu le jour au moment où sa mère [est] entrée dans la nuit » – le père pense d’ailleurs qu’après avoir « donné naissance à cinq garçons, sa femme n’était pas exercée à concevoir une fille ». En réalité, l’affaire est bien plus complexe que cela – et le livre ne manque pas de rebondissements qui font voler en éclats tous nos préjugés en matière de genres, de races et d’origines familiales. Le père aurait pu s’effondrer ou se laisser glisser, mais il a su garder « la tête hors de l’eau et les lèvres éloignées du goulot » en choisissant de vivre dans une cabane avec ses enfants, muni de « la fierté de ne rien devoir à personne » dans ce delta de Văcărești, un espace sauvage, un « royaume » qu’ils considèrent comme le leur et dont ils connaissent chaque recoin. Ils vivent de chasse et de pêche ; ils ont des poules, des cochons. Le père sculpte des figurines d’animaux « dans des bois arrachés au delta » et qu’il va ensuite vendre « en ville les jours de marché ». Cette petite troupe est accompagnée du (vieux) chien nommé Moroï – baptisé ainsi car il a refusé « de se voir ôter la vie sitôt après l’avoir reçue » : destiné à être noyé avec les six autres chiots d’une portée, il est remonté à la surface, et selon les légendes des régions de la Bucovine et de l’Olténie, les moroï sont « les réincarnations des enfants morts-nés ou tués dès la naissance ».
Dans cet univers où chaque chose résonne selon un chant et des champs existentiels différents pour ne pas dire opposés à notre modus vivendi actuel, les liens sociaux n’ont pas la même consistance ni les mêmes implications. Le père s’oppose à l’acquisition de la culture « écrite dans les livres » : des « foutaises » tout juste bonnes à « raboter le cerveau » de sa progéniture – « On pourra allumer le poêle avec les copeaux de votre cervelle », lance-t-il aux enfants. Ces derniers accèdent malgré tout en secret à l’instruction grâce à tante Marta, personnage charnière du livre (à l’instar d’une autre femme imposante nommée Mémé Zizi), mêlée plus qu’on ne le croit d’abord aux Șerban et qui prodigue son enseignement à Sasho. Lequel le répercute auprès des autres membres de la fratrie dans une grotte secrète où il dissimule les livres nécessaires aux leçons. Notons avec tendresse (car c’est un détail crucial qui constitue une sorte de fil rouge émotionnel dans le livre) que la petite Naya, d’abord effrayée par la menace du père, s’ouvre à la culture grâce à une revue évoquant « la réintroduction des bisons d’Europe dans les Carpates ». La force et la beauté de ces animaux, « dont elle n’aurait jamais soupçonné l’existence » sans cela, font qu’elle décide qu’une « telle découverte valait bien le sacrifice de quelques copeaux de cervelle ». Ce moment du texte, qui peut paraître anodin, incarne pourtant l’acmé de l’histoire – et je ne suis pas près d’oublier cet émerveillement de Naya qui tournera à la tragédie.

Car tout va voler en éclats à la suite d’une décision de transformer le lieu de vie des Șerban en une réserve naturelle pour la faune et la flore – « un vaste programme écologique soutenu par l’Europe » qui ne tolère pas leur présence sur place. Il faut les « rayer de la carte de Văcărești » – alors que, soit dit en passant, les centaines de milliers de visiteurs nuiront bien davantage à l’environnement que les respectueux Tsiganes qui connaissent la nature mieux que personne. Pour convaincre les Șerban de débarrasser le plancher, et avant de recourir à des méthodes autrement plus ignobles pour « anéantir l’espoir d’une existence dans les marges », on leur promet monts et merveilles : de l’emploi, un logement confortable – alors qu’ils se retrouvent parqués dans le ghetto tsigane de Bucarest, entassés dans un deux-pièces « infesté de rats ». C’est le quartier de Ferentari, désigné comme une « poche de pauvreté » dont on ne peut s’extraire que « les pieds devant » : sida, tuberculose, drogue, prostitution y sévissent… Précisément tous les fléaux dont le père avait voulu protéger ses six enfants.
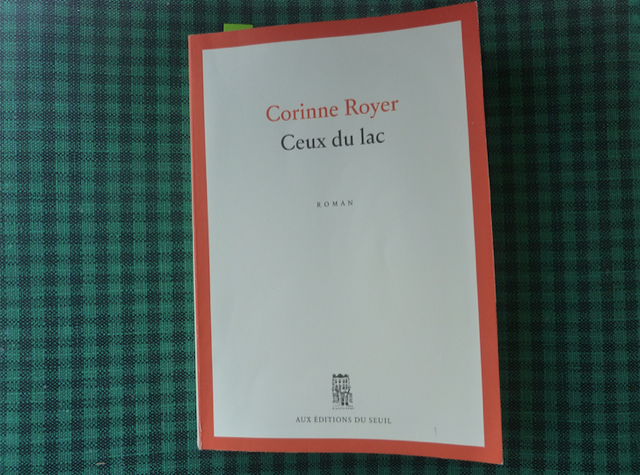
À partir de ce séisme, telle une succession d’irradiations venant se fondre dans l’œil du cyclone, toutes les existences se disloquent, toutes les mémoires s’entrechoquent, tous les mensonges émergent tels des maléfices, toutes les souffrances s’exacerbent – l’histoire même de la Roumanie recrache ses terribles douleurs, Ceaușescu et ses abominations, la haine vis-à-vis des Tsiganes. Le rejet se fait assassin alors que dans le secret des antériorités familiales, dans les coups malins du destin et le labyrinthe des amours clandestines, nul ne peut plus dire qui il est vraiment, et de quel sang il est issu. La catastrophe est en marche, mais Sasho, l’aîné, saura la sublimer bien au-delà de la plaie mortelle de l’exclusion. Sa poésie est une victoire de l’humanité. Son hommage au rêve de sa petite sœur Naya est fondamentalement ce que nous devons retenir du très beau roman de Corinne Royer : le prix à payer pour la liberté d’exister est certes élevé, mais rien, non vraiment rien n’arrêtera le désir d’être un papillon ou celui de rencontrer les bisons. Qu’on se le dise après avoir lu Ceux du lac.
Martine Roffinella
Écrivaine-photographe
Ceux du lac, roman de Corinne Royer, est publié aux Éditions du Seuil.