Il y a peu j’évoquais ici les Œuvres de Sylvia Plath, et ce n’est donc pas un hasard si aujourd’hui j’aborde avec humilité une autre « grande voix féminine américaine », ainsi qualifiée par les éditions Rivages : Susan Taubes – et son incroyable livre Vies et morts de Sophie Blind (Divorcing, pour le titre original), dont la lecture m’a été recommandée par Josyane Savigneau (grand merci pour cela !).
Entrer dans cet ouvrage, c’est d’abord et paradoxalement, à l’instar d’une héroïne nommée Blind – soit : « aveugle » en anglais comme en allemand –, accepter d’être désaveuglé ; donc de s’aventurer sans filtre en terre littéraire inconnue. Dès la première page c’est un tourbillon stylistique qui nous tient les yeux écarquillés. Où est-on ? On n’en sait rien. On est comme dans le wagon d’un grand huit, le souffle coupé et levant la main à chaque paragraphe pour dire : « Mais… mais ! » Dans sa Préface, la traductrice Jakuta Alikavazovic confirme : « J’étais dans le livre et je ne savais pas du tout où j’étais » – avant d’ajouter : « C’est normal : son héroïne, Sophie Blind, ne savait pas non plus où elle était » et « à l’en croire », elle venait « à proprement parler de perdre la tête ».
D’une façon extravagante et extraordinairement réjouissante, il est donc impossible de résumer les Vies et morts de Sophie Blind – tout comme, si l’on y réfléchit bien, il est illusoire de prétendre condenser les nôtres. Car nos multiples existences et disparitions – à nous, les femmes – n’ont pas d’ancrage propre : elles dépendent d’histoires et de racines tressées par les autres ; essentiellement des hommes. Pour acquérir sa propre personne la femme doit mourir, sa tête se « détacher » (rompre – divorcer) et son corps « [devenir] énorme, ses centaines de milliards de cellules soudain libérées ». Pour aller où ? Des fragments de Sophie Blind nous percutent. Elle qui s’habille en noir parce que c’est ce qui va le mieux avec les bijoux offerts par son mari ; elle qui a « toujours rêvé » d’une chemise de nuit blanche en coton – « Mais ça, Ezra ne comprenait pas pourquoi » : n’est-elle pas « mieux toute nue » ? Ce même Ezra qui excelle à provoquer des scènes de ménage pour l’avilir – car ce n’est là « qu’une femme » ; « rien qu’une femme » qu’il s’emploie à rendre « malléable » et « fluide [d’une] fureur » qu’il transmute à son avantage : « son épouse bien-aimée, il savait bien ce qu’il allait en faire, et neuf mois plus tard, un bébé était là ».
Longtemps Sophie est cette jeune épouse « stoïque et innocente » d’Ezra Blind, rabbin de son état en même temps qu’universitaire viennois : « C’était beau d’être toujours occupée, harcelée ; se faire sucer jusqu’à la moelle, c’était l’essence même de la vie, elle en devenait presque transparente. » Et puis elle décide que « CE MARIAGE EST TERMINÉ ». Le « processus d’annulation » de sa personne – « c’était comme d’être évidée » – lui est enfin apparu. Aussitôt elle est traitée de folle. C’est un psychiatre qu’il lui faut ! Ah… mais non… puisqu’en cet instant du texte nous apprenons que Sophie est morte. Elle aura donc droit à un enterrement juif – et « il y aura un moment, juste avant la mise en terre, où le rabbin devra se tourner et, face à l’assemblée des fidèles, demander s’il y a une objection ». Sophie Blind voit tout cela – cesse d’être blind – ; elle est le cadavre lucide de toutes ses vies, et aussi celui de son arbre généalogique entier, qui contient les dépouilles d’Auschwitz. « Le cercueil attend, suspendu. »
Des « objections », y en aura-t-il ? Le livre entame alors la genèse de ce qui pourrait en constituer. Ne faut-il pas en finir avec « l’histoire ancienne » qu’incarne Ezra, le mari rabbin ? Les Juifs ne sont-ils pas eux-mêmes « de l’histoire ancienne » – « Basta, le passé, qu’on en finisse avec le Mur des lamentations » ? Sophie Blind, d’abord spectatrice morte de son propre procès de divorce, s’attend à voir surgir tous ceux de sa famille exterminés dans les camps nazis. Mais la voilà projetée dans un vortex temporel où elle est à la fois née et à naître. Elle, Sophie Landsmann, dont l’origine sur sept générations remonte à 1730 : « les vies de deux cent cinquante-deux individus, hommes et femmes, ont dû se croiser et cent soixante-seize noces ont dû être consommées » afin qu’elle puisse voir le jour. Elle peut ainsi connaître, en tant que morte, ses antécédents viscéraux, tout ce qui la compose (le fameux atavisme) et explique son union avec Ezra : « C’est l’histoire de son mariage à un homme auquel il importait qu’elle fût la petite-fille de l’ancien grand rabbin de Budapest […]. » Est-ce pour autant une erreur généalogique ?
La réponse, comme tout ce que contient ce livre hors du commun, n’est peut-être pas celle attendue. Sophie Blind vit des vies qui n’ont pas été les siennes mais dont la sienne dépend, et que son statut de morte en procès permet d’incarner dans tous leurs errements et quiproquos. Et nous sommes là, dans cette espèce d’âme qui va de l’un à l’autre de ses ancêtres, cette drôle de bulle où quelque chose d’elle suinte. Quoi ? Peut-être la phrase de son père, ce psychanalyste célèbre, qui se sent « parfois coupable du fait qu’elle soit née » – de la « souillure » qu’est pour lui son mariage avec cette Kamilla tellement originale dont il divorcera. Une mère absente, un fantôme théâtral (« J’ai accepté l’idée que je n’ai pas de fille […]. Tu es une étrangère pour moi ») aux multiples soupirants et dans lequel Sophie se « dissout ».
Vies et morts de Sophie Blind, de Susan Taubes, est aussi le roman de l’expatriation, de « l’accident historique » que constitue le déracinement obligatoire en 1939, quand la traque aux Juifs oblige le père et la fille, alors âgée d’une dizaine d’années, à quitter Budapest par bateau pour les États-Unis. Et Sophie s’aperçoit qu’elle n’a « jamais vraiment quitté » ce bateau-là. Pourtant – acmé de l’ambiguïté qui sublime le livre – « se retrouver à New York, grotesquement échouée, semble faire sens. Étrangement ».
Susan Taubes s’est suicidée en 1969, peu de temps après la parution de Divorcing. Nous tenons donc entre nos mains, redécouverte en 2020, non pas une œuvre testamentaire censée nous transmettre tels préceptes en vue du Sacré Bonheur, mais bel et bien la clé de notre émancipation. Une phrase de la chanteuse Barbara, que j’ai eu la chance de rencontrer, ne m’a plus jamais quittée une fois entendue : « Je veux bien mourir, mais je ne veux pas qu’on me pousse. » Il n’est pas question d’autre chose ici.
Martine Roffinella
Écrivaine-photographe.
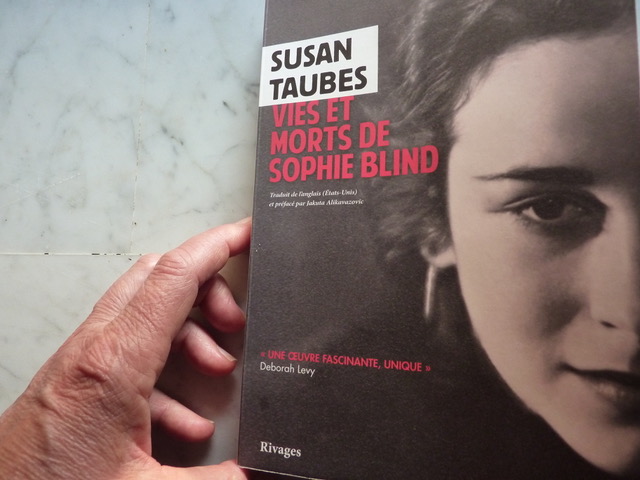
Encore une chronique époustouflante qui donne plus qu’envie de découvrir ce livre. Une sorte d’urgence.
Bizarrement cela rejoint et réveille le choc ne de ma rencontre inattendue avec « Haute enfance », mon premier Joyce Carol Oates. J’en parle dans mon livre à paraître en octobre.
Ceci dit, Martine je ne peux pas suivre, vous allez trop vite ! 😉
Merci pour votre lecture attentive, chère Danièle ! Ce livre est incroyable. Et il faut vraiment remercier Josyane Savigneau qui me l’a recommandé – à la suite de la précédente parution sur le blog à propos de Sylvia Plath. Ces écrivaines américaines ont tout osé. Je poursuivrai cette épopée dans les semaines qui viennent avec Anne Sexton.