Dès la lecture de l’exergue : « Fais-moi penser d’apporter une corde demain » (Beckett), on sait que quelque chose va se passer là tout de suite dans ce roman, et que ce ne sera pas banal. Les Éditions de Minuit, toujours aussi inventives, nous donnent à découvrir le talent diablement cocasse de Marion Guillot.
C’est Marie, ma libraire préférée (de chez Charlemagne, à Hyères, dans le Var), qui a attiré mon attention sur C’est moi, surprenant, drôlissime et très astucieux roman d’une auteure que je ne connaissais pas : Marion Guillot. Les oiseaux de mauvais augure annonçant depuis quelques lustres la mort du roman en tant que genre peuvent revoir leur sinistre prédiction ! Ici nous avons du neuf, du frais, du délicieusement cruel – tout pour être extrait de ce monde-ci et plongé dans ce monde-là, empruntant ce qu’il faut au réel pour le sublimer et le recréer sous la bannière fiction, dont on sait la réussite lorsqu’elle touche à l’universel.
« Charlin est mort hier. »
Le lecteur est informé que « dans le fond », Charles-Valentin, dit Charlin, « devait être quelqu’un de sympathique ». Tout de suite la puce nous est mise à l’oreille, d’autant que pour les obsèques de ce Charlin, il n’y aura « pas de messe ni d’encens, pas de prêtre en chasuble mauve ». On a beau nous expliquer que ça n’a « rien de très surprenant », justement nous en avons déjà l’eau à la bouche – mais que s’est-il donc passé ?
D’accord, ce copain de classe et meilleur ami de Tristan, compagnon de la narratrice, ne sait pas parler « de grand-chose à part de billards et de filles, au mieux de circuits électriques », et il a la fâcheuse habitude de « débarquer à l’improviste, de préférence à l’heure des repas et neuf fois sur dix les mains vides ». D’accord aussi, les « carcasses de bière », les « plaisanteries potaches » et autres discussions « prolongées parfois jusque tard dans la nuit », ça agace, et on se sent franchement solidaire de celle qui parle, car plus Charlin s’impose, plus Tristan « s’éloigne » d’elle. Et « forcément », ça la « crispe », d’autant qu’elle « accuse le coup de la quarantaine » (« partout, désormais », on l’appelle « Madame »). Alors qu’est-il donc arrivé pour que ce parasite (qui m’a fait penser à certains cloportes mille fois pilés en rêve !) soit retrouvé mort ? S’est-il bienheureusement fait renverser à un carrefour, alors qu’il s’était enfin déplanté du couple pour regagner son propre domicile ?
Non, non, vous n’y êtes pas du tout : on l’a retrouvé « seul chez lui (…) avec les yeux exorbités et surtout une corde autour de son cou ».
Le puzzle d’une vie qui se morcelle
Tristan est au chômage et cherche « vaguement du travail (…), s’étant vite découragé de recevoir ces lettres types mentionnant toute l’attention portée à sa candidature, mais surtout qu’il n’avait pas le bon profil ». Il sort « de moins en moins » et s’occupe à faire des puzzles. La narratrice essaie de partager avec lui cette occupation durant le week-end, mais l’on sent bien que le couple lui aussi se transforme en pièces éparses irrégulièrement découpées, de plus en plus difficiles à assembler – car quelle est l’image à constituer ? Au bout du compte, Charlin seul semble distraire Tristan, et « on aurait pu rester longtemps comme ça, à se fréquenter autant qu’à se fuir, à partager, sur fond d’ennui, tant de soirées et de fatigue, lui, son foutu copain, et moi ».
Le mauvais plan d’une « excellente surprise »
Dans une mise en scène absolument hilarante, que la narratrice nous restitue avec un style enlevé à la fois précis, charnu, et d’une ironie joyeusement cinglante, Tristan conçoit alors l’idée d’un cadeau « vraiment original » : d’un certain point de vue il ne manque pas son coup, puisqu’il sidère la narratrice, mais pas franchement – doux euphémisme – dans le registre d’effet escompté. Difficile pourtant de faire la moue, même si « son excellente surprise, il pouvait se la mettre où je pense ». Car ce cadeau incarne « l’amour que Tristan » lui porte, « son désir de ne pas [la] perdre de vue, qu’on se rapproche ou qu’on ne se laisse pas aller ».
Alors de quoi s’agit-il ?
« Tu ne bouges plus et à trois, tu ouvres les yeux ; attention, un…, deux… »
Et à « trois » le lecteur découvre la surprise en même temps que l’héroïne, ce qui le rend à 100% complice de l’auteure (joli petit tour de force littéraire !). Dans un « immense cadre de bois neuf », « au milieu du salon plein ouest » et occupant « presque toute la surface du mur », trône, « démesurée et en gros plan », une photographie de la narratrice nue. Et bien sûr, l’indéboulonnable Charlin a participé, moyennant finances (alors que le couple a « d’autres priorités », Tristan étant sans emploi, « et pas de fric à jeter par les fenêtres »), à la réalisation de cette « surprise » – « bon sang qu’est-ce que t’étais bien foutue », commente-t-il grassement.
À partir ce moment-là, le roman devient diabolique. Marion Guillot nous entraîne méthodiquement dans la logique implacable de la narratrice, dont nous partageons les émotions et surtout le désir d’interrompre, de façon définitive, un trajet de vie qui a été décidé sans elle. Elle prend la main, ou les rênes – c’est le moins que l’on puisse dire, et à titre personnel je m’en suis bien réjouie. Il y a la scène mémorable de ce bain de mer « dans l’eau froide de fin avril », où cette fois elle s’exhibe nue « de son plein gré », fendant « la barrière des vagues que créaient le vent et la roche joints à l’inclinaison de la plage ». Le monde semble alors « doucement s’ouvrir ». La semaine suivante, elle achète deux mètres quatre-vingts de corde, après avoir « longuement hésité » entre la « blanche tressée en polypropylène, très maniable, recommandée pour le camping » et la « torsadée en chanvre, biodégradable, idéale pour l’arrimage ».
Pour quoi faire et selon quel dessein ?
Impossible de vous en révéler davantage – ce serait détruire toute la magie de ce livre qui se dévore justement d’une traite grâce au (ou à cause du) suspense qui y règne jusqu’à la dernière page. C’est un de ces romans que l’on reprend au début une fois l’issue révélée. Pour ma part, j’ai spécialement apprécié ce détail, a posteriori doublement savoureux, donné dans les premières pages, le jour de l’incinération de Charlin, ce « meilleur ami » de Tristan : « il faisait beau, c’était déjà ça. »
Martine Roffinella : Marion Guillot, racontez-nous comment vous est venue l’idée de cette intrigue irrésistiblement drôle, au service pourtant d’une tragédie contemporaine : celle du chômage et de ses répercussions pluridimensionnelles. Êtes-vous partie d’un « détail » autour duquel vous avez tissé l’histoire, ou bien aviez-vous dès le départ toute l’intrigue en tête ?

Marion Guillot : Vous me faites très plaisir non seulement en évoquant la drôlerie du récit mais aussi en employant (même – ou a fortiori – entre guillemets !) le mot de « détail » : pour pouvoir commencer à écrire, j’ai effectivement besoin d’un élément infime, à partir duquel réfléchir, combiner, construire. J’aime travailler à partir de l’élémentaire (à partir duquel, à mon sens, tout se joue), réfléchir à partir d’un point nodal ou d’un microcosme. Et tant que je n’ai pas ce point de départ très précis, net, irremplaçable, aucun dispositif ne peut se mettre en place.
Parallèlement, j’ai besoin (même si c’est très effrayant !) que tout ne soit pas là dès le départ, d’avoir cette inflexion initiale, mais de ne pas clairement savoir ce qu’elle va offrir, de ne pas connaître non plus tout de suite les perspectives qu’elle va ouvrir ou fermer avec elle. J’ai besoin de vivre ce moment angoissant, excitant, où l’on se sent à la fois embarqué et où l’on prend conscience qu’il va falloir, pendant une durée impossible à déterminer a priori, naviguer totalement à vue !
Pour C’est moi, dans ou sur l’arrière-plan de ce couple à peine en dérive que j’avais – au moins vaguement, je crois – déjà à l’esprit, c’est moins une idée (par exemple, je n’ai pas songé explicitement à écrire un livre sur le chômage) qu’une image qui s’est imposée et qui a déclenché (comme un déclencheur d’appareil-photo) l’intrigue : cette grande photographie de la narratrice nue. Si, d’une certaine manière (fort différente, d’ailleurs !), et très partiellement, la scène au funérarium constituait, en lambeaux, une trame narrative déjà présente, rien n’aurait pu se faire sans cette photographie particulière, cet élément à la fois visuel, intime, matériel qui m’a fait signe, et auquel il me semblait décisif de donner sens.

M. R. : Votre narratrice incarne-t-elle pour vous une génération spécifique – si oui, laquelle ? En tant que femme, comment se positionne-t-elle dans l’espace-temps que vous avez choisi pour la faire vivre ?
M. Gu. : Peut-être incarne-t-elle en tout cas un âge (que, toutefois, je n’ai pas encore atteint, d’où des projections éventuellement fantasques ou fantasmagoriques !) où j’imagine l’on éprouve, peut-être plus qu’à d’autres moments de l’existence, des difficultés à se situer. Se situer dans le temps (celui de la vie, celui aussi, de l’époque à laquelle on appartient : dans le livre, il y a des détails techniques, mobiliers, quelques scènes de la vie de bureau, qui essaient de suggérer cette époque, ses lignes de fuite, ses insignifiances…), dans la durée (celle qu’on a parcourue et sur laquelle on ne peut revenir, celle qui s’étale encore devant, avec ses promesses, ses prospections et ses inquiétudes), dans l’espace urbain (avec les modifications qu’il implique, l’uniformisation des zones pavillonnaires, par exemple), dans l’espace, aussi, qu’on occupe, avec soi-même et avec les autres (ne serait-ce que parce que c’est parfois difficile d’occuper un espace – même si c’est un espace ouvert comme la rue, par exemple – à plusieurs…).
La narratrice, du reste, est anonyme, essentiellement désignée par des appellations sociales (vous le rappeliez : partout – ou presque… –, désormais, on l’appelle « Madame »). Au début du roman, en tout cas, en tant que femme (là encore, au risque de vous décevoir, je ne crois pas avoir envisagé dans ce livre une réflexion aboutie sur la féminité) mais aussi, pour commencer, en tant que personne, elle n’est renvoyée à elle-même que par le regard qu’on porte sur elle et les univers (matériel et intérieur) dans lesquels elle évolue. De ce point de vue, elle me semble d’autant plus susceptible de refléter cette période équivoque, complexe, sereine et inquiétante à la fois, de la quarantaine où il s’agit peut-être non plus de se découvrir ou d’apprendre à se connaître, mais plutôt de trouver une manière de s’identifier ou se désigner (à laquelle le titre peut faire écho), de se prolonger dans le monde et persévérer dans l’être, avec, contre ou sans les autres.
M. R. : La découverte de la photo d’elle-même, nue, accrochée dans le salon du couple et lui faisant face, constitue visiblement un choc pour la narratrice, qui va bien plus loin qu’une simple gêne ou un agacement. On a l’impression d’un séisme : pourriez-vous nous en dire plus sur ce point ?
M. Gu. : Votre question me semble indissociable de la seconde, et je vous remercie des recoupements ou développements que vous m’invitez donc à faire. Effectivement, l’intrusion de ce portrait dans l’appartement de la narratrice implique que, brusquement et contre sa volonté, la narratrice se trouve dans l’incapacité de déterminer si elle est la source ou l’objet des regards, si elle est focale ou point de fuite, si son compagnon la regarde ou regarde une image d’elle, si son appartement lui permet de regarder sereinement le monde extérieur ou si, au contraire, il projette sur elle tous les regards de l’extérieur. De fait, elle se trouve simultanément – et c’est cette démultiplication des regards qui m’intéressait – décentrée et renvoyée de plein fouet à elle-même, forcément aux prises avec la difficulté de déterminer sa place.
L’expérience qu’elle fait de cette image, en ce sens, me paraît tout à fait différente de celle qu’on peut faire de soi-même dans un miroir. D’ailleurs, « dans le miroir », la narratrice entretient, dit-elle, un rapport presque clinique ou neutre à elle-même, en tout cas un rapport plus léger. Face à une photographie, en revanche, et cette photographie singulière tant dans sa nature, son cadre que dans ses proportions ou son contexte, il me semble qu’elle se confronte soudainement à un quadruple malaise : le malaise de la rencontre violente d’une image disproportionnée (là où celle du miroir est en taille réelle et reste, à moins qu’on soit parfaitement imbu de sa personne, dans des proportions raisonnables) ; d’une image inquiétante car fixe, là où celle du miroir est vivante et mobile ; d’une image potentiellement reproductible, alors que celle du miroir est toujours unique ; enfin, d’une image exposée, donc éventuellement publique, visible de tous, quand celle qu’on a de soi dans le miroir reste limitée à l’espace de la salle de bains, par exemple, et renvoie plutôt à l’intimité. Bref, autant vous dire que je suis parfaitement d’accord avec votre idée de « séisme » !

M. R. : Le personnage de Charlin paraît immédiatement familier au lecteur. Comment l’avez-vous conçu ? Avez-vous hésité entre plusieurs types de parasites ? Ou bien est-il une sorte de condensé de tout ce qui a le don de nous exaspérer (même si nous sommes tous le « Charlin » de quelqu’un…) ?
M. Gu. : Je l’envisage plutôt comme un « condensé ». Ne serait-ce que pour des raisons liées à une manière personnelle de travailler : de fait, j’essaie, autant que possible, de m’éloigner des situations ou des personnes qui pourraient m’être familières (si cela peut, en même temps, créer l’effet inverse sur le lecteur, c’est formidable!), ou, en tout cas, que ces situations ou ces personnes soit combinées, diluées, amalgamées ou reconstruites dans le travail. Cela implique donc que si j’ai sans doute, comme tout le monde (!), des « Charlin » à disposition, celui du roman n’en désigne aucun en particulier, ou alors les rassemble tous (!).
Plus largement, je crois que, finalement, Charlin, qui pourtant ne brille pas par sa complexité ou sa finesse (!), a été le personnage le plus difficile à construire, à manier et apprivoiser, et qui reste à mes yeux, encore aujourd’hui, le plus glissant. En l’imaginant, certaines tournures du film noir me sont revenues, ce qui a dû m’aider à composer son profil de souteneur ou presque, à suggérer sa gouaille, ses manières de se tenir, de parler… L’idée, en tout cas, oui, très certainement, était de proposer comme un écho à la photographie, voire un double vivant de celle-ci, une figure de tiers envahissante, presque corrosive, un élément non seulement perturbateur mais « parasite » (vous m’arrachez le mot de la bouche !), quasiment aliénant, impossible à contourner, qui exacerbe le sentiment de saturation de la narratrice, qui concentre les exaspérations.
M. R. : Votre écriture installe dès les premiers mots un climat d’étroite complicité entre le lecteur et vous. Un peu comme si vous nous mettiez d’emblée de votre côté, dans une confidence entendue ayant un fort effet valorisant. Comment vous y prenez-vous ? Pouvez-vous nous expliquer votre façon de travailler sur la langue ?
M. Gu. : Je suis persuadée – ce qui n’a rien d’original – que l’histoire n’est pas là d’abord, puis racontée dans la langue, mais, au contraire, que le travail sur/de/avec la langue, à la fois dans l’infinité de possibilités, la réflexion d’ordre structurel et les contraintes qu’elle implique, est absolument indissociable de la constitution d’une trame narrative et d’une intrigue. C’est ce qui explique peut-être mon extrême lenteur dans le travail (!), tout comme ma quasi-absence de notes ou de brouillons, et l’impression constante que tant qu’une phrase n’est pas achevée, tant que je ne parviens pas à lui donner le rythme, le ton et la teneur que j’attends d’elle, la suivante est résolument impossible à construire.
En ce sens, en amont voire indépendamment de toute histoire, je vis (et cela me permet d’être moi-même surprise à chaque ligne !) la pratique de l’écriture non pas comme la manifestation d’une pensée qui serait déjà là et qu’il suffirait de coucher sur le papier, mais avant tout comme une rencontre, un jeu, un combat avec la langue qui va non pas exprimer mais agencer un réel, figurer des perspectives, une atmosphère, constituer une unité qu’on ne peut pas anticiper. C’est d’ailleurs, il me semble, la condition pour ne pas séparer funestement le fond et la forme.
Dans C’est moi, ce qui s’est imposé assez vite, outre la nécessité d’apprendre à construire une évidence (en ce sens, vous me faites très plaisir, là encore, en disant qu’on peut reprendre le livre au début, une fois l’issue révélée, justement peut-être pour voir comment cette issue s’est construite), c’est une forme, nouvelle pour moi, d’oralité (de ce point de vue, je crois, par exemple, m’être autorisé des tournures syntaxiques et un lexique qui n’apparaissaient pas dans mon premier roman), jointe à une tendance récurrente de la narratrice à commenter les situations qu’elle est en train de vivre, les impressions qu’elle éprouve, donc non seulement à expérimenter mais à faire retour sur ses expériences, parfois de manière burlesque ou loufoque, ce qui a peut-être insufflé (j’ai très envie, j’avoue, de faire sourire mes lecteurs…) un peu d’humour dans le texte, ce qui m’a, en tout cas, offert des occasions, parfois vertigineuses, non seulement de confirmer mon goût des détails mais de combiner différentes strates, différents registres, niveaux d’écriture ou d’interprétation, de superposer des approches multiples du réel, aussi.
Si, comme vous le suggérez, cela peut créer une complicité avec le lecteur, le mettre de mon côté (ou du côté de la narratrice), ce qui m’échappe un peu, forcément, ou en tout cas échappe à mes prévisions, puisque si c’est évidemment une vive espérance, cela ne peut être l’objectif initial, alors c’est une sacrée chance, la plus belle cerise sur le gâteau !
Article paru dans la revue Genres le 24 mars 2018.
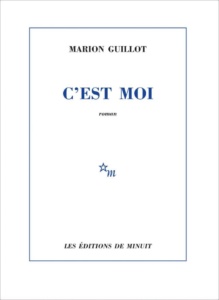 C’est moi
C’est moi
Marion Guillot
Éditions de Minuit
12 euros