 Qui n’a pas un jour rêvé de rompre avec la « marche accélérée » du monde ? Qui n’a pas souhaité s’extraire de la « densité » citadine et « se poser » en paix « sur un rocher pastoral » ? Une Parisienne et sa compagne franchissent le pas et s’installent dans une « petite commune de deux cents âmes ». Félicie Dubois nous livre leurs Joies (pas si) simples.
Qui n’a pas un jour rêvé de rompre avec la « marche accélérée » du monde ? Qui n’a pas souhaité s’extraire de la « densité » citadine et « se poser » en paix « sur un rocher pastoral » ? Une Parisienne et sa compagne franchissent le pas et s’installent dans une « petite commune de deux cents âmes ». Félicie Dubois nous livre leurs Joies (pas si) simples.
Que sont nos campagnes devenues – est-il possible à deux femmes en couple, issues de la grande ville, de s’y transplanter ? La greffe entre « rurbains » (avides de qualité de vie) et locaux (dont « le passé survit encore au présent ») a-t-elle pris, à l’ère de la mondialisation et de l’addiction à Internet ?
Bienvenue à Sainte-Barbe, « entre mer, marais et bocages », où se déroulent Les Joies simples que Félicie Dubois nous invite à partager. Un quotidien campagnard, parfois extrait ou tombé d’une autre réalité (planète ?), qui vient ici nous rappeler avec quelle brutalité la logique des puissants s’exerce sur les jugés « rétrogrades ». C’est le roman « incarné et souriant » de la ruralité intime que Félicie nous offre, avec toute la pudeur à la fois tendre et distanciée, mais jamais angélique, du style inimitable qui est le sien, ciselé au quart de millimètre de mot près, visant juste à tous coups.

« Au début du troisième millénaire après Jésus-Christ, le monde a considérablement rétréci »
C’est le constat que dresse la narratrice. Densité humaine, (« surcharge immédiate »), frontières kilométriques abolies, vie à marche forcée en mode accéléré… il fallait donc trouver « le Lieu », se « fixer en un point précisément localisé », dégotter un village ayant « conservé toute sa place ». C’est Sainte-Barbe et ses deux cents Barbenchons. Le couple pose ses valises là, dans « une maison tricentenaire à quelques encablures du bord de la mer », avec un jardin « découpé en quatre carrés délimités par de petites bordures de buis ». George, la compagne de la narratrice, « perpétue le mouvement de balancier entre lieu de naissance et lieu de résidence », soit entre Paris et le village d’adoption. Tandis que le « je » qui parle se « sédentarise peu à peu, pas à pas » et « traverse les heures dans l’espoir d’observer ce qui d’habitude est caché ».
« Tout a changé, ça change tout l’temps »
Après leur installation, les (ex) Parisiennes auraient pu se contenter, comme c’est souvent le cas, de vouloir reconstituer à la campagne leur confort urbain, c’est-à-dire éliminer, souvent sans ménagement, ce qui dérange. À l’image par exemple des procédurières « dames Charnier » (le nom n’est pas anodin), qui déclarent n’être « pas du même monde » que le paysan à qui elles ne cessent de chercher des noises concernant, entre autres, son troupeau de vaches. L’homme finit par en mourir.
« Des murs sont tombés tandis que d’autres se dressent », note la narratrice qui, elle, cherche à s’insérer à la vie locale – avec succès, comme en témoigne la restitution savoureuse du déroulé du Conseil municipal. On y débat de « l’attribution d’une prime de fin d’année à mademoiselle Leclerc », mais aussi « de faire travailler quelqu’un de chez nous plutôt qu’une grosse boîte internationale » (c’est pourtant cette dernière qui remporte le marché, car « les gros mangent les petits »), de la disparition programmée des petites communes en France par le système complexe des regroupements, alors que les hautes instances semblent tout faire pour que « les gens ils soient confusionnés » – « Ce n’est plus de la démocratie, c’est de l’oligarchie ! ». Nous sourions jaune.

Des voix pastorales sauvées de l’extinction
Par le biais de sa description minutieuse de toutes les activités du village (l’épisode relatif au cimetière est un pur délice), Félicie Dubois nous présente, sans l’annoncer comme tel, à tous les habitants du village, dont peu à peu, au détour d’une remarque, nous découvrons l’histoire. Et c’est bien là toute la magie de ce livre, qui l’air de rien nous émeut aux larmes, quand le voile est levé sur les chemins de vie parfois tragiques de ceux taxés d’« arriérés ». Ce ne sont pas des personnes qui déballent leur vie sur Internet, et pourtant que de destinées âpres et rugueuses !
Plus nous avançons dans le roman, et plus nous nous attachons à ce petit monde dont nous avons beaucoup à apprendre, notamment dans le domaine de l’abnégation. En témoigne le personnage de La Mouche, qui nous touche en un endroit que nous pensions peut-être oublié ou désuet : pas celui, très en vogue, de la compassion, mais peut-être simplement ce petit lieu près du cœur où l’affection sans a priori ni intérêt luit.
Chaque élément de cette « chronique d’un village français » est à déguster sans modération, même si (et justement à cause de cela !!!) parfois, comme lors de la séquence de « la vendue à Nicol » (foncez au chapitre 12 du livre, et vous saurez ce qu’est une « vendue »…), l’ambiance est celle d’une « nouvelle de Guy de Maupassant ».
Autant de merveilles littéraires qui paraissent répondre à la question, pas si anodine que cela, soulevée par la narratrice : « Que restera-t-il de George et moi quand nous ne serons plus là ? »
Mais c’est sans doute La Mouche qui a le dernier mot : « Quand tu comptes tous ceux qu’ont rejoint le Seigneur depuis la création du monde, hé ben ils sont plus nombreux qu’les vivants » – et un compère d’ajouter : « Nous sommes minoritaires. »
Martine Roffinella : Félicie Dubois, comment décririez-vous le chemin parcouru entre la parution, en 1989, de votre premier roman Maria Morena (éd. Lieu Commun), qui connut un fort retentissement, et ces Joies simples ? Existe-t-il selon vous une logique d’écriture dans ce cheminement, ou bien est-ce la vie qui a forgé votre inspiration au fil de ses aléas ?

Félicie Dubois : Ma vie se confond avec ce que j’écris : qui de la poule ou de l’œuf ?
Mes cinq premiers romans jusqu’à Punto Final (paru en 2010, mais composé entre 1999 et 2003), sont des enquêtes d’identité — je voulais savoir « qui je suis » (née sous X, j’ai longtemps cherché ce qui se cachait derrière ce X, symbole de l’inconnue en mathématiques) ; les derniers (et notamment le recueil de nanoromans intitulé De l’Ange à l’huître) sont en quête d’une terre promise — j’espérais me poser quelque part. Il m’a fallu également rendre hommage à mes parents en littérature : Tennessee Williams et Jane Bowles. Comme Jane et Tennessee, je suis un écrivain organique. Écrire est une fonction vitale.
Errance ou cohérence ? Une traversée de trente années (mon Dieu !) dont une dizaine de livres, romans et biographies, est la trace.
M. R. : Comment avez-vous conçu la structure si originale de votre livre ? Avez-vous d’abord récolté les scènes campagnardes puis construit la trame autour ? Ou bien tout s’est-il imposé simultanément, avec vous, auteure, en cheffe d’orchestre pour assembler les voix de ce roman choral ?
Je suis la cadence d’une petite musique capricieuse, obsédante.
C’est de la marqueterie, un travail en mosaïque, une composition.
Le texte reste ouvert jusqu’à la fin (dans Punto Final, par exemple, il n’y a pas de point final), il est polyphonique (comme ce roman choral), il n’impose aucune conclusion — sinon une impression.
Je prends beaucoup de notes que j’assemble ensuite tel un puzzle dont l’image apparaît au fur et à mesure des correspondances. Je vois le texte autant que je l’entends, guidée par une tonalité (de couleurs et de sons) et soutenue par un rythme (une ponctuation).

M. R. : Dans votre ouvrage, vous évoquez assez peu le quotidien de la narratrice avec George, et pourtant tout est dit : « (…) je vis des noces d’or. George me pousse toujours vers le beau, le bon, le bien, en faisant mine de me laisser une totale liberté. » Vous évoquez avec amour « les joies simples de l’esclavage ». Pourriez-vous nous en dire plus sur ce clin d’œil au titre ?
F. D. : George apparaît pour la première fois — et en détails — dans Une mouche vole, un des quatre nanoromans du recueil intitulé De l’Ange à l’huître (éd. Jean Paul Bayol). Je ne peux résister à la tentation d’inviter le lecteur à plus de plaisir de lecture encore en se référant à cet ouvrage injustement négligé…
Quant au clin d’œil au titre… Je vais vous faire une confidence : le livre s’appelait initialement Les Joies simples de l’esclavage, mais l’éditeur a pensé avec perspicacité que l’expression, trop équivoque, pourrait prêter à confusion — n’est-ce pas ? — étant donné qu’il n’y a pas mais alors pas une seule scène d’intimité explicite entre les deux femmes, si ce n’est leur communion à chaque page.
M. R. : En lisant votre roman, on a l’agréable impression de dévorer plusieurs livres à la fois, dans une pluralité de strates temporelles simultanées que ne renierait pas Virginia Woolf (notamment dans Mrs Dalloway). Est-ce finalement la narratrice qui fait la jonction entre toutes les vies ? Ou l’inverse ?
F. D. : La réponse jaillit de votre question ! C’est une combinaison !
Je vous remercie infiniment pour cette référence à Virginia Woolf, peut-on rêver plus délicieuse compagnie ?
M. R. : De son chien, Attila, la narratrice écrit : « Il est, pour moi, un genre de greffon ; je suis, pour lui, une sorte de station d’accueil. Nous réalisons le vœu des adeptes du transhumanisme. » N’est-ce pas finalement la définition de l’amour – en tant que « station d’accueil » – qui fait de l’intégration de ce couple de femmes une réussite ?
F. D. : Oui, l’amour est un abri. Tant que la porte est ouverte.
Article paru dans la revue Genres le 10 avril 2018.
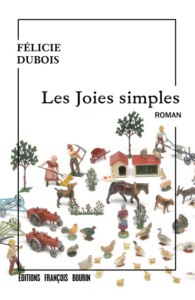
Les Joies simples
Félicie Dubois
Éditions François Bourin
16 euros