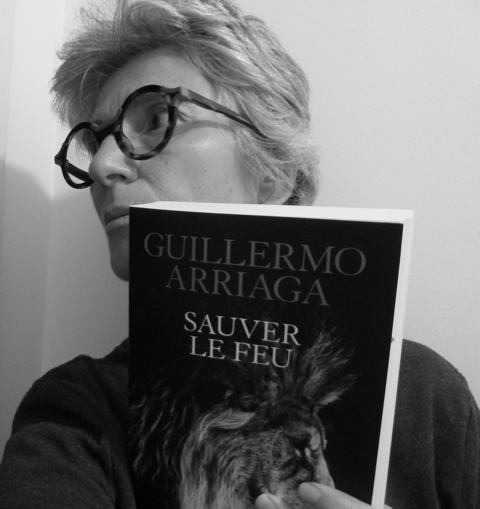J’ai découvert l’œuvre de Guillermo Arriaga au début des années 2000, alors que j’étais salariée des éditions Phébus où il a notamment fait paraître Un doux parfum de mort ainsi que L’Escadron Guillotine – deux très remarquables romans traduits de l’espagnol (Mexique) par François Gaudry. C’est à présent la maison Fayard qui le publie et Sauver le feu, traduit par Alexandra Carrasco, confirme le génie hors normes de cet écrivain qui sait mieux que personne explorer les failles humaines et ce qu’elles supposent, ou pas, comme résurrection(s).
Remarquons d’abord la composition astucieuse de cette vaste fresque littéraire, la pluralité stylistique subtilement mosaïquée qui y fait œuvre, nous révélant ainsi une infinité de tableaux éruptifs de couleurs, d’odeurs, de mots ciselés, broyés, fondus, sculptés au burin ou à la lame. Une jouissance d’emblée que les scènes de sexe, non pas crues mais palpables, démultiplient jusqu’à, si j’ose dire, nous en boucher un coin et même plusieurs. Le livre nous agrippe. Nous y rencontrons une foultitude de personnages pétris d’instincts, aux prises avec leurs démons[1] ou leur conscience souvent paraphrase du mot enfance, lui-même synonyme de dévastation. Dans le même instant, s’agitent de simples pantins sociaux qui paraissent ignorer l’existence d’abîmes qu’ils longent pourtant les yeux ouverts. Ces mondes et ces gens empilés verticalement en toute étanchéité nous sont à la fois étrangers et atrocement familiers. Ils ne glissent jamais vers la caricature. Ils agissent, infléchissent le Destin au forceps avant d’être à leur tour violemment manipulés au cœur de situations et de micmacs politiques bunkérisés. « C’est la faute de la fatalité », aurait peut-être répété Charles Bovary. Sauf qu’il y a un homme – José Cuauhtémoc, qui purge une peine de 50 ans de prison ; sauf qu’il y a une femme – Marina, danseuse, bourgeoise, rangée. Est-il encore temps pour une faille, c’est-à-dire notre salut ?
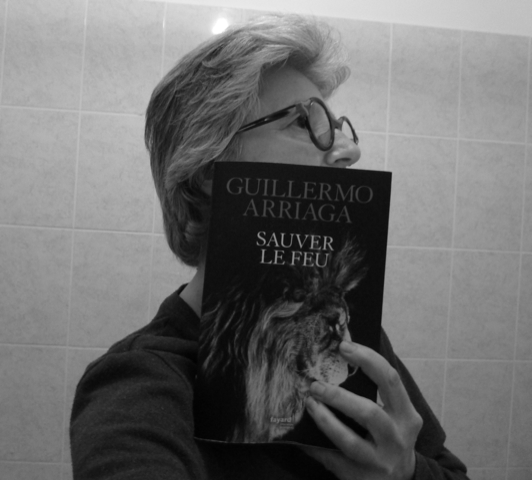
Sauver le feu est un régal mêlé d’exultation massive et d’impatience cannibale (les nuits sont courtes avec Arriaga !). L’affaire se déroule au Mexique et, indique la 4e de couverture, nous « entraîne dans l’escalade de violence » qui y règne – tout en nous offrant « un tableau criant de vérité du fossé qui sépare l’élite du pays des classes les plus précaires ». Soit. Mais si ce postulat aurait pu en quelque sorte, ici en France, paraître exotique il y a une vingtaine d’années, il est, au fil des 760 pages que compte le livre, comme une préfiguration de ce qui nous attend. Il faut donc lire Arriaga avec de multiples regards, savourer son talent unique pour mettre au jour nos questionnements et nos contradictions, nos lâchetés et nos désormais infimes possibilités de regagner une dignité. Plusieurs histoires se croisent et s’entrecroisent dans ce roman, cette épopée, cette traversée (criminelle ? sacrificielle ? divine après tout ?) de cœur et de corps, de vérité du sang versé, vécu, bu. Il y a quelque chose de christique là-dedans, et il se peut que ce soit l’amour, la communion à mort. Lisant Arriaga, nous glissons vers notre propre aventure qui s’annonce rude – aurions-nous eu/aurons-nous bientôt le talent de « sauver le feu » plutôt que notre confort ?
Rien n’est moins sûr.
Martine Roffinella
Écrivaine-photographe.
[1] Dans le domaine de la jalousie amoureuse poussée à son insupportable paroxysme, je me suis sentie parfaitement en phase avec un dénommé Durite [sic] – les gens qui ont lu mon roman Mise à nu (Phébus) comprendront pourquoi. Ni oubli ni pardon. Et BANZAÏ !