Si pertinente dans notre contexte sanitaire actuel, La Mort d’Ivan Illitch touche au génie par le mécanisme addictif de ses rouages littéraires. Tout emporte, tout transporte, tout aimante – de la justesse du propos à l’écriture même de Tolstoï – dans une histoire universellement nôtre.
À peine plongée dans La Mort d’Ivan Illitch, je suis aspirée par ces pages qui sont pour moi la perfection, à savoir qu’elles résorbent ce qui m’entoure, absorbent le plus mince de mes soucis pour m’engloutir corps et âme dans une histoire où fond et forme se subliment.
De quoi s’agit-il ?
De vous, de moi face à l’extinction prédite dès notre venue au monde, dans un compte à rebours que nous prenons soin d’ignorer, faisant comme s’il ne concernait que les mortels, ceux des cimetières, qui préfèrent reposer en paix. Grand bien leur fasse ! Quant à nous, il est évident que nous ne mourrons pas, et moins encore à la fleur de l’âge : nous avons bien autre chose à faire – trépasser n’entre pas dans nos plans.
Pour l’anecdote, ma mère me raconta un jour qu’elle avait longtemps pu chasser la terreur inconsciente que lui inspirait la mort en multipliant mentalement son âge par deux : tant que le calcul n’excédait pas les 90 ans, tout allait bien – l’obéissante Camarde ne viendrait pas la prendre avant l’échéance prévue !

Telle est la thématique de La Mort d’Ivan Illitch, à savoir cette « programmation » de ce que notre vie doit être dans l’espace qui nous est accordé entre naissance et disparition, alors même que plus nos plans s’élaborent, et plus l’instant du départ définitif est occulté, voire nié.
L’histoire d’Ivan Illitch, que Tolstoï a tirée d’un fait divers, est « simple, banale et la plus affreuse qui soit ». Fils de fonctionnaire, conseiller à la cour d’appel, marié convenablement avec Praskovia Fédorovna, puis respectable père de famille, Ivan Illitch est « très comme il faut ». Sa vie, il l’a lui-même façonnée afin qu’elle soit « agréable et décente ».
Mais il rend pourtant son dernier souffle à l’âge de 45 ans. Sans dévoiler ce qui, à un moment précis de l’existence si bien huilée de ce « procureur chevronné », constitue le grain de sable, amené avec brio par Tolstoï, il est possible de révéler que « quelquefois », Ivan Illitch se plaint « d’une saveur désagréable dans la bouche et d’une impression de gêne dans le ventre » – mais bien sûr, cela ne peut « passer pour une maladie ».
Cependant tout se gâte, son humeur comme son corps, il n’est bientôt plus question de « mener une existence heureuse, mais seulement de sauvegarder les apparences ».
Rien n’est plus « comme il faut », l’état de santé d’Ivan Illitch s’aggrave sans qu’il puisse obtenir de réponse claire : il est alors contraint de « vivre au bord du gouffre, sans personne pour le comprendre ou s’apitoyer sur son sort ».
Soudain il prend conscience qu’il risque d’y passer : « N’est-il pas évident pour tout le monde excepté moi-même qu’en ce moment je me meurs (…) J’étais ici, je vais là-bas… Où donc ? (…) Je ne serai plus. Mais qu’y aura-t-il donc ? (…) Et où serai-je, quand je ne serai plus ? Est-ce la mort ?… Oh ! je ne veux pas ! »
Ivan Illitch ne veut ni ne peut admettre l’idée de son trépas – c’est bien bon pour les autres, mais pas pour lui. « En effet, Caius est mortel. Mais moi, moi, Vania, moi, Ivan Illitch, avec toutes mes pensées, toutes mes sensations, n’est-ce pas autre chose ? Il est impossible que je doive mourir. Ce serait trop affreux ! »
Plus il considère sa mort comme incongrue, plus il perçoit tout ce qui l’environne comme un vaste mensonge, et plus sa haine pour son entourage le mine.
C’est alors que la confrontation avec lui-même, avec cette vie qu’il voulait tellement exemplaire, a lieu. Tant qu’il aura la conviction d’avoir « bien vécu », il se démènera « comme le condamné à mort dans les bras du bourreau », et son « propre acquittement » le rivera à la vie, suscitant d’atroces souffrances.
Cette prise de conscience, menée de main de maître par Tolstoï, ne transforme pas pour autant le récit en un monologue d’auto-analyse ou en une plainte victimaire.
La fiction, plus forte que le réel, plonge le lecteur dans un décor où il prend place, tour à tour au chevet d’Ivan Illitch et devenant lui – avec cette inévitable question que nous crions tous un jour : « Pourquoi moi ? »
À l’ère de ce moi-régnant et de l’égotisme à tous crins, l’immense écrivain Tolstoï nous fournit une réponse sans appel.
« C’est fini ! » dit une voix au-dessus de lui.
Il entendit ces mots et les répéta dans son âme.
« Finie la mort ! songea-t-il… Elle n’existe plus ! »
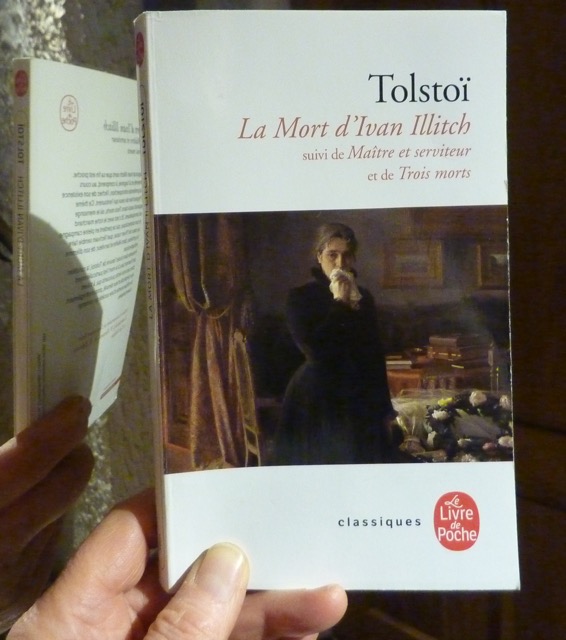
Léon Tolstoï : La Mort d’Ivan Illitch, traduction de Michel-R. Hofmann – suivi de Maître et serviteur, traduction de Boris de Schlœzer, et de Trois morts, traduction de J. W. Bienstock. Éditions Le Livre de poche « Classiques ».
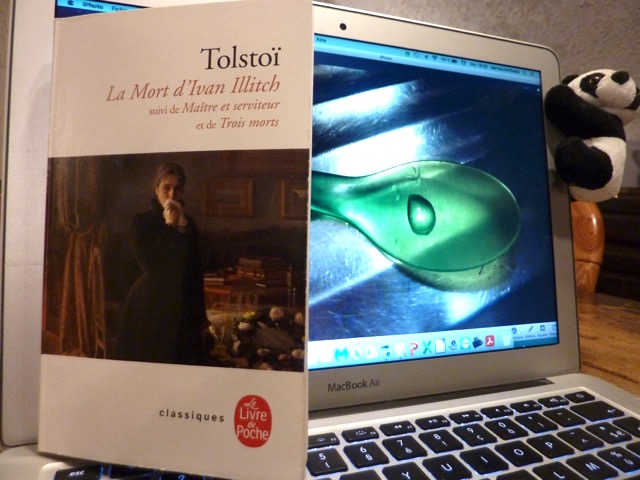
Vous donnez envie de le relire, Martine, ce grand texte qui, à mon avis, n’a jamais été égalé. Il a fallu beaucoup de courage à Tolstoï pour l’écrire, un courage que je n’aurai jamais, je crois.
La magie de la littérature russe opère toujours. A travers ce constat de l’échéance de chacun, il transparaît dans cette écriture du maître, tout ce qui est justement la vie et ses articulations, et qui fait son maintien à respirer et penser avant tout, pour tenir debout, et mieux envisager ce contraste entre le passage du vivant et celui du départ…
Merci encore, Martine, de redonner la flamme au mythe de la littérature russe.
Merci Martine pour cette juste, sensible et belle chronique !
Ce qui est génial avec Tolstoï dans ses nouvelles , c’est la justesse dans le choix des mots. Cette apparente simplicité dans non seulement la narration mais aussi dans la description des sentiments au travers de son environnement. Avec des personnages attachants. J’aime !
Excellente chronique ! Tolstoï est mort à 82 ans, mais sa compréhension de la mort prématurée est saisissante. Un roman à lire ou à relire.