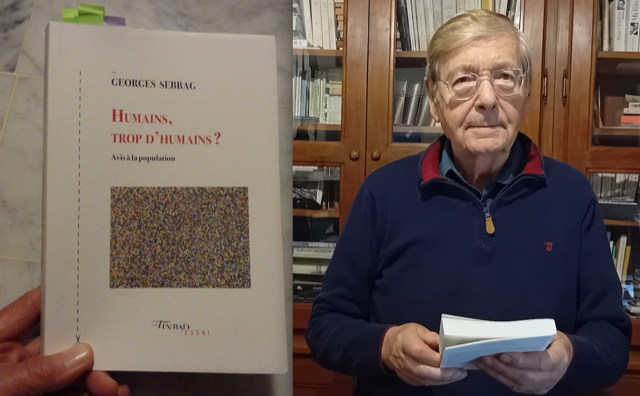Marcherons-nous bientôt sur la tête à force de pulluler sur nos deux jambes ? Notre « instinct de reproduction implacable » creusera-t-il notre propre tombe, à supposer qu’il subsiste encore quelque place pour nous enterrer ? Au XXe siècle, la population mondiale a quadruplé pour atteindre présentement les 8 milliards d’individus, au prix de la « dévastation d’une multitude d’espèces vivantes » et bien sûr du « saccage du milieu naturel ». Georges Sebbag s’étonne : « Comment ne pas s’apercevoir que la population déborde sur terre […] ? » Avec toutes les conséquences que cela implique – pénurie d’eau, manque de ressources alimentaires et diminution de la surface habitable : « […] la terre est aujourd’hui cinq fois moins étendue qu’en 1850 puisqu’elle est cinq fois plus peuplée qu’alors. » Dans Humains, trop d’humains ? Georges Sebbag constate : nous sommes en surnombre. Mais le plus inquiétant, c’est notre refus de le voir, de le comprendre et surtout de l’admettre. L’homme semble incapable d’observer le phénomène de sa quantité. Sebbag cite en ce sens Witold Gombrowicz : « Je suis un homme – certes. Mais un parmi bien d’autres. Combien ? Si je suis un parmi deux milliards, ce n’est pas la même chose que si j’étais un parmi deux cent mille. » Notre déni du surnombre, explique brillamment Sebbag, génère une falsification de toutes nos perceptions, qu’il s’agisse de nous-même(s) ou de l’espace temporel qui nous est imparti et que nous pensons pouvoir modeler à notre façon – au moyen d’une modernité qui « carbure à l’oubli » pour mieux occulter « l’auto-extermination programmée » qu’implique la surnatalité toujours glorifiée. La pression démographique entraînera sous peu le déplacement de dizaines de millions de personnes – c’est inéluctable. Et pourtant, les masses demeurent « irresponsables » et « non conscientes » de leur nombre. Car la procréation est un sujet tabou. Et soulever l’hypothèse d’une régulation des naissances provoque l’indignation – alors que, souligne Sebbag avec justesse, la surnatalité mondiale suscitera bientôt des crimes et exterminations « au regard desquels les deux guerres mondiales, la shoah et le goulag apparaîtront comme de simples épisodes préparatoires ». Pourtant, dans l’absurde aveuglement qui est le nôtre, nous privilégions l’accroissement au nom d’une « philanthropie de bon aloi ou d’un humanisme bêlant ». Une société du « gâtisme volontaire » et de « l’affadissement des identifications collectives » générant « la mise sous le boisseau de l’idée du grand nombre ». Tout cela, à savoir « l’impensé démographique des néo-natalistes », est rendu possible par la mise en place des « durées artificielles » visionnées sur les petits et grands écrans : le sujet « procède à sa propre désubjectivation », se regardant désormais comme « une durée au contact d’une autre durée ». Et c’est bien ce qui m’a le plus intéressée dans ce magnifique travail de Georges Sebbag, qui s’appuie sur de nombreux créateurs et penseurs, dont il sera question ci-après. Pour ma part j’ai été subjuguée par son analyse autour de l’œuvre d’Antonio Saura, mais tout vaut le détour (le chapitre VI : « Se multiplier et s’entredévorer (Claude Cahun) » est un délice). Les microdurées médiatisées et filmiques nous régissent désormais et c’est par ce « trou d’épingle de la durée que nous percevons autrui » autant que nous-même(s). Voilà le « génie du troupeau » ainsi proclamé – ce « grand nombre » où nous sommes tous « photogéniques », comme en témoigne l’ère du selfie (egoportrait), alors que parallèlement, « la multitude fait cuire à l’étuvée les individualités qui la composent ».
Le travail de Georges Sebbag, haletant de la première à la dernière page, constitue par maints aspects un choc, mais surtout la meilleure occasion de nous regarder en face – non pas pour nous exhiber sur les réseaux sociaux, mais peut-être pour nous sentir mortels. Je vous invite à approfondir ce débat en lisant à présent l’interview à laquelle l’écrivain et docteur en philosophie a accepté de répondre.

Quatre questions à Georges Sebbag
MARTINE ROFFINELLA : Quel a été le point de départ de la réflexion que vous nous livrez dans Humains, trop d’humains ? Y a-t-il eu un élément déclencheur, une interpellation artistique spécifique, ou bien est-ce le résultat d’une longue observation préalablement nourrie de votre expertise philosophique ?
GEORGES SEBBAG : Comme vous le suggérez, des sentiments et des raisons mêlés m’ont amené à me préoccuper du flot continu et irrésistible des populations humaines. Voilà longtemps que j’ai noté qu’une telle foule exponentielle n’embellissait pas notre monde et que, bien au contraire, en raison même de son exubérance, la terre se réduisait peu à peu comme peau de chagrin. J’ai aussi observé que cette grande marée démographique pouvait être associée à un certain délitement des relations sociales, dont La Foule solitaire de David Riesman rendait déjà compte dans les années soixante. Désormais, la famille, l’État ou la chose publique sont plutôt à ranger au magasin des accessoires. Notre seule appartenance, horizontale et fantasmatique, est celle des individus du grand nombre. Toutefois, s’il subsiste un postulat politique, ce serait : la démographie gouverne la démocratie. Je voudrais rappeler que selon Jean-Jacques Rousseau, natif de Genève, la démocratie n’est viable que cantonnée à un petit nombre de citoyens.
M. R. : En sous-titre à votre essai, figure la mention Avis à la population – une invitation à « se regarder dans la glace » pour celle qui feint d’ignorer « l’énorme boursouflure de son propre nombre ». Si vous deviez placarder cet Avis sur un mur, que contiendrait-il – en concurrence langagière avec les « durées brèves » qui composent notre nouvel alphabet émotionnel ?
G. S. : L’avis à la population placardé sur les murs et répercuté, il va de soi, sur les écrans multimédias, proclamerait : « Humains, trop d’humains, concurremment à vos corps et vos guenilles qui ont atteint le trop-plein sur terre, vous avez engendré une quantité incalculable d’images de vous-mêmes ; vous avez fabriqué des pastilles d’un nouveau genre, des microdurées qu’on peut visionner à perpétuité ; individus du grand nombre, vous vous baignez avec délectation dans un “public universel”, une humanité improbable ; à un moment où les sciences et les techniques ont l’immense pouvoir de modéliser, calculer et numériser, vous semblez vous aveugler volontairement sur une réalité élémentaire, celle du peuplement de notre village planétaire. Y a-t-il ou non un seuil au nombre d’humains sur terre ? Cinq milliards ou dix milliards ? C’est à vous de le décider. » Mais cet avis à la population serait aussitôt englouti sous des amoncellements d’images fugaces ou d’actualités autrement frappantes et retentissantes. Au fond, nous ne nous représentons plus autrui, qu’il soit proche ou lointain, comme un être de chair et de sang, comme un être vivant destiné à mourir, nous préférons le fantasmer pour mieux l’immatérialiser, l’artificialiser ou l’immortaliser.
M. R. : Quelle est l’essence commune – si elle existe – entre les différentes personnalités que vous convoquez dans votre ouvrage (Jonathan Swift, Charles Fourier, Robert Malthus, Claude Cahun, Witold Gombrowicz, Antonio Saura…) ? Et quel rendez-vous nous fixez-vous avec elles, à travers votre propre synthèse de certains aspects de leurs œuvres ?
G. S. : À travers ces penseurs, écrivains ou artistes, courent un esprit d’aventure, une spéculation libre et un brin d’humour. On ne peut pas ne pas se référer à Malthus qui s’est attaqué directement à la question dans son Essai sur le principe de population. J’admire, à différents titres, Jonathan Swift, Charles Fourier, Claude Cahun, Antonio Saura, auxquels j’adjoindrais quelques poètes surréalistes. Je mettrai au centre de cette joyeuse équipe le romancier polonais Witold Gombrowicz, car c’est celui qui a tout naturellement mis dans le mille. En 1962, dans son Journal, il se demandait comment Démocrite, Saint François d’Assise ou Brahms évaluaient la population mondiale de leur temps. D’où ces quotients, 1 sur 400 000, 1 sur 50 000 000 et 1 sur 1 000 000 000, qui traduisent l’irrésistible dilution de l’individu dans la masse humaine. D’où cet éclatant paradoxe : les sociétés traditionnelles qui faisaient peu de cas des individus exerçaient sur eux un poids démographique bien plus faible que les sociétés modernes censées émanciper l’individu.
Pour le dire autrement, aux yeux d’un individu, est-il préférable de vivre au sein d’une humanité rare ou d’une humanité boursouflée ? Est-il glorieux ou piteux que l’humanité passe de 8 milliards d’humains à 10 milliards d’humains ? La question n’est pas anodine. Tous les ressorts de notre pensée et de nos existences sont affectés ou concernés – logique et morale, métaphysique et esthétique, économie et politique, sciences, arts et techniques.
M. R. : Face aux « génies » qui « se ramassent à la pelle » au sein de notre « ultramodernité avide d’inventions », quelle est finalement la position du philosophe qui ne se contentera pas d’un bêtifiant c’était-mieux-avant ? Nous faudrait-il transgresser l’actuel interdit de la disparition et réapprendre à mourir ?
G. S. : Il y a un clin d’œil à Nietzsche dans le titre Humains, trop d’humains ? ainsi que dans celui d’un précédent ouvrage, Le Génie du troupeau. Plus nous sommes nombreux, et plus nous avons la grosse tête. Les génies courent les rues et nous n’avons aucun mal à les rattraper. Les individus du grand nombre se contemplent dans le miroir du public universel et croient être seuls au monde. Mieux encore, depuis une trentaine d’années, nous nous sommes placés sous la coupe de l’humanitaire sanitaire, qui nous a langés et vaccinés, secourus et choyés, allant même jusqu’à nous sommer de ne pas mourir. L’impératif catégorique n’est plus d’ordre moral mais médical. Un raisonnement à la docteur Knock s’est emparé de tous les rouages de la société mondialisée : nous sommes des malades qui s’ignorent. Il est interdit de mourir et nous devons passer notre vie à nous soigner. Tout est mis en œuvre depuis les campagnes de prévention jusqu’aux services des urgences. L’humanitaire sanitaire, qui avait fait ses preuves auprès des blessés des guerres ou des populations affamées, se targue à présent d’assurer une couverture universelle sur tous les maux physiques et mentaux des populations mondialisées. Les cohortes de soignants (médecins, psychiatres, infirmières, psychologues, esthéticiennes, pharmaciens, coachs, etc.) et leur entourage administratif seront bientôt en passe d’égaler en nombre celui du personnel enseignant. D’où cette question abyssale : qui soignera les soignants et qui instruira les enseignants ? L’accent mis sur la santé physique et mentale de tous nos contemporains pourrait être interprété comme un point aveugle et comme l’aveu d’un aveuglement vis-à-vis de la surpopulation.
J’aurais tendance à penser qu’à chaque époque éclosent des choses formidables et d’autres minables. Je retiendrais deux propositions, s’il fallait établir une analyse critique des cinquante années passées : 1. Nous avons mis de côté le temps continu et linéaire et avons adopté une nouvelle temporalité, celle du temps sans fil. 2. Notre humanité n’est pas proportionnelle à notre quantité.
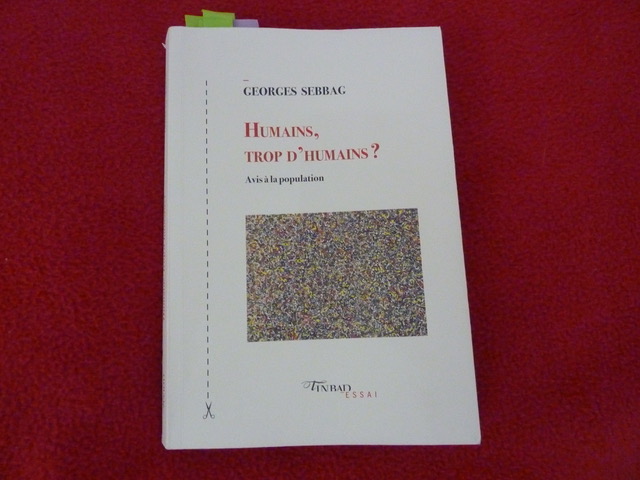
Humains trop d’humains ? – Avis à la population, de Georges Sebbag, est publié aux éditions Tinbad.