« Il y avait quelque chose dans cette voix, le rythme, l’intonation, la précision, l’animation, la musique, en somme, qui m’a attirée », dit Anne Bouclier, l’éditrice chez Piranha de Natacha Diem. L’histoire de cette « Invention d’Adélaïde Fouchon » est si touchante que j’ai invité ces deux femmes formidables à venir la raconter ici. Ouvrez l’œil et le cœur !
Se glisser dans la peau de l’enfant que nous avons été au moyen d’une mémoire adulte n’est pas aisé – il faut quasiment parvenir à se dissocier, à quitter l’épaisse cuirasse du souvenir formaté.
Certains événements capturent notre personne et l’embarquent presque sous la contrainte dans une sorte de machine à remonter le temps – faussement loyale, car c’est souvent une volée d’éclats que nous prenons en pleine âme.
Natacha Diem, dans un premier roman qui évite l’écueil du nombrilisme, offre à chacun·e une place de choix dans cette enfance-là, cette vie de femme adulte-là, cette prise de conscience-là, alternant l’ici et l’ailleurs, le tout-de-suite et le naguère avec une agilité, un humour et une poésie souvent décapants.
« Mon père est mort », dit la narratrice – et c’est sans doute le « moment » de « se poser la bonne question, la vraie, celle d’une vie » – « le jour où il est mort, je ne pouvais plus y échapper et je suis partie à sa recherche et j’ai trouvé, je l’ai retrouvée, la petite fille ».
Nous faisons ainsi la connaissance d’Adélaïde et de sa famille : « Papa numéro un, papa numéro deux, maman, mon frère, Raspoutine, mon chat, Éluard, mon hamster, et mon poisson laveur de vitre » – et de préciser à sœur Marie-Chaussette, sa nouvelle maîtresse à l’école Notre-Dame (alias Marie-Josette, dit avec « un cheveu sur [la] langue »), qui s’étonne de ce « papa numéro deux » : « Les deux amoureux de ma maman » – « Ma maman a tous les matins une double portion de bisous. »
Ce à quoi il lui est aussitôt répondu : « Tu parles trop ! Ce ne sont que des mensonges. »
Quel·le enfant – et quelle que soit sa situation familiale – n’a pas ressenti ce que plus tard l’on nomme injustice, mais qui sur le moment, pendant ce temps secret et indescriptible que sont les quinze premières années de notre vie, n’est qu’une sorte de blanc mental, d’interrogation qui ne peut être éclairée ?

Nous touchons là à ce que le roman de Natacha Diem contient de plus précieux : l’exact déplacement de la narratrice adulte dans le corps et la mosaïque de pensées spontanées spécifiques à l’enfant.
Mais attention, qu’on ne s’y trompe pas ! Spontanéité ne veut pas dire naïveté ni vérité, et Adélaïde apprendra très vite à se composer plusieurs personnalités – à « inventer », à être « moi et pas moi » – car « que faire, que dire à part mentir ? ».
C’est peut-être cette même question que se pose la femme dont le père est mort, qui vit en couple et a des enfants, mais qui doit aussi « jouer la fille pour qui tout va bien ».
Que peut donner cette traversée somme toute assez risquée entre enfance et temps présent ? – « Je rétrograde et en même temps j’avance », dit la narratrice, « je suis couchée dans une prairie de douleurs et d’amour, l’errance est mon chemin ».
Je ne vous en dévoile pas davantage et préfère laisser la parole d’abord à Natacha Diem puis à son éditrice : Anne Bouclier.
Deux femmes ardemment habitées qui viennent ici nous raconter tour à tour leur aventure avec L’Invention d’Adélaïde Fouchon.
Natacha Diem raconte…

J’ai commencé à écrire assez tard, je pense que je devais avoir environ vingt-cinq ans.
Lorsque j’étais enfant, je m’exprimais plus par la danse, le chant et ensuite par le dessin. Je virevoltais beaucoup, je papillonnais, je passais d’une activité à l’autre au gré de mes envies.
Je montais aussi des spectacles, pour ma famille, mes amis, et avec une décontraction totale. Même pas peur des jugements.
Cela a bien changé depuis.
Comme tout enfant qui grandit, et sans doute, en ce qui me concerne, un peu trop vite, j’ai commencé à avoir des doutes, particulièrement sur l’être humain et sa nature. Hé oui, un enfant peut philosopher sans savoir qu’il philosophe.
Je me suis rapidement demandé pour quelles raisons les enfants étaient parfois si méchants et les adultes tellement étranges.

À cette époque-là, je n’écrivais pas beaucoup ; par contre je regardais énormément de films. Je ne vivais pas ces films comme des fictions mais comme des possibles. Sans que je m’en rende compte, ils nourrissaient mon imagination. Je chantais également. Seule dans ma chambre, je vocalisais toutes ces chansons et ça provoquait en moi de l’exaltation.
Il faut dire que mes parents écoutaient beaucoup de musique française dont Brel (oui, je sais, il était belge), Ferré, Brassens, Ferrat, Aznavour, Barbara et j’en passe. Toutes ces chansons et ces paroles me nourrissaient comme si j’étais un oisillon qui devient beau en grandissant.
C’est cela qui est merveilleux avec l’éducation, car oui, c’est de l’éducation : la culture transmise spontanément, simplement parce qu’on offre une musique, une chanson, et le bonheur qui va avec.
Je voue toujours un amour sans bornes à Brel. J’aime tout chez cet homme. Il me donne des frissons. Sa voix, son timbre, ses mimiques, ses grandes dents et sa tristesse. Il est la puissance de la vie. Je sais que je m’éloigne un peu, mais pas tant que ça : c’est important, parce que c’est aussi ce qui a nourri mon désir d’écrire.

Je suis nulle en musique, je veux dire que je n’ai jamais vraiment pratiqué d’instrument (à mon grand regret), mais mon rêve serait, je pense, d’être parolier, parolière (je préfère).
J’adore écrire des histoires courtes, mais apparemment les Français n’en sont pas friands. Et une chanson qui marque raconte souvent une histoire courte. Bon, j’arrête mes digressions.
Une rupture eut lieu en moi vers l’âge de 25 ans.

Une cassure, comme si je me rendais compte que le chemin que j’étais en train de prendre n’était pas le bon.
Je ne savais plus vers où aller et comment y aller.
C’est à ce moment que j’ai vraiment commencé à écrire.
En écrivant, je retrouvais des chemins possibles, des vies que je pouvais imaginer, un destin à construire par l’écriture.
J’écrivais des histoires qui parlaient beaucoup d’enfants et parfois qui parlaient de moi, enfant. Je suis fascinée par les enfants, je pense que ça transparaît dans mon roman.

Tout enfant est un poète en herbe. Tout enfant détient en lui tous les possibles. C’est la société et les adultes qui rompent ces possibles. C’est visible dans le regard d’un bébé, cette soif de découverte, et le rire d’un enfant, son émerveillement devant des choses que nous, adultes, ne voyons plus, c’est magique. À ce propos, je suis d’une curiosité sceptique quant à la place de l’enfant dans notre société, au sort de l’éducation nationale, mais ce sont d’autres sujets. Revenons à l’écriture.
Vers mes vingt-cinq ans, elle est devenue comme une frénésie. J’écrivais partout, tout le temps, et tous les sujets y passaient : l’amour, les amis, la famille, la douleur, les bonheurs, la nature, les animaux.
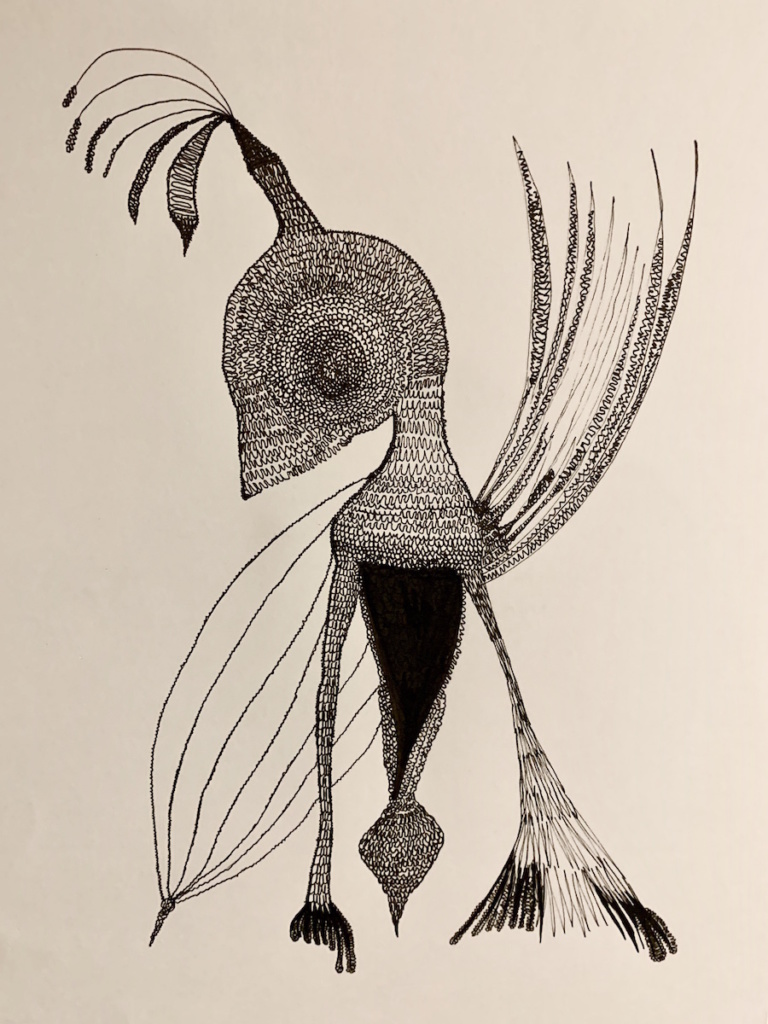
Plus j’écrivais, plus l’introspection se dessinait : essayer de comprendre comment je fonctionnais, d’où je venais, et surtout qui je désirais devenir, était récurrent.
Les feuilles s’entassaient, les carnets puis les documents Word sur mon ordinateur. J’avoue que je n’écris plus que sur ordinateur depuis quelques années. La plume est trop lente.
Cela me faisait du bien de coucher sur papier ce que je ressentais, ce que j’imaginais, ce que je désirais.
Ça ne s’est plus jamais arrêté : écrire sans savoir où cela me mène.
Quand je me suis installée à Paris, le métro, que je prenais tous les jours pour aller travailler, est devenu un lieu d’inspiration. Il y avait aussi les bistrots. J’observais les gens, j’écoutais leurs conversations.
Pour en revenir au métro, n’étant pas parisienne d’origine, il me fascine, il est le pouls de Paris. Je me souviens de m’être assise à côté d’un jeune trisomique. Il feuilletait un magazine sur Bob Marley. À chaque page tournée et découverte, son visage s’illuminait. Il avait des écouteurs et je pouvais entendre Bob Marley chanter. Le gamin caressait les pages. Il pouvait vraiment toucher Marley. C’était le plus heureux de nous tous dans cette voiture.
Moi aussi, plus jeune, j’ai été carrément amoureuse de Bob Marley, alors je me suis demandé pourquoi ce n’était plus moi qui feuilletais un magazine sur Marley. J’avais envie de parler à cet enfant et de lui expliquer que moi aussi, gamine, j’avais été une groupie du chanteur. Je n’ai pas osé. Je ne sais pas pourquoi. Pour ne pas le déranger ? Par peur du regard des autres ?
Voilà le genre de petite histoire que j’aime et que j’aime écrire. Ce petit bout d’homme, car il devait avoir seize ans au plus, était une grâce, une coloration de la vie. J’avais devant moi le bonheur incarné. Ce moment était à la fois une délectation et une remise en question de mon être.
Pourquoi n’arrive-t-on pas, une fois adulte, à être aussi heureux qu’un enfant ?
Ou si on l’est, qu’est-ce qui nous empêche de le montrer ? C’est une des grandes questions que je me pose encore constamment. C’est une des raisons pour lesquelles je suis extrêmement sensible à des films comme Une femme sous influence, Big Fish (un de mes films préférés de Tim Burton et pas le plus connu), les films de Charlie Chaplin, Un tramway nommé désir. J’aime ces personnages instables, à la marge, ces personnages qui ont une perception, une sensibilité hors du commun. Récemment, j’ai revu Les Lumières de la ville et les trois personnages principaux : Charlot, la jeune aveugle et le bourgeois sont si attachants.
Les personnages sans faille ne m’intéressent pas ou seulement très peu.
Et la faille prend souvent son origine dans l’enfance et, paradoxalement, il faut l’embrasser et ne pas la fuir.

Dès qu’un adulte agit ou s’exprime comme un enfant le ferait, il est considéré comme bizarre. S’il ose rêver, imaginer à outrance, ou simplement se foutre de ce que les autres pensent (évidemment tant que cela reste respectueux des gens), il est considéré comme étrange et, du coup, presque dangereux.
Cette prise de conscience a eu lieu vers mes trente ans, quand je suis moi-même devenue mère : je trouvais que les mères se ressemblaient toutes, par exemple, à la sortie de l’école : On y est, je suis mère, c’est du sérieux. Je cherchais le petit brin de folie chez elles mais aucune ne me l’offrait. C’est comme si une fois devenue mère, on doit devenir quelqu’un de sérieux. Pour moi, c’était inacceptable. Pour moi, c’était violent.
J’écrivais déjà à cette période, et l’écriture faisait son chemin, mêlant des moments autobiographiques et d’autres qui étaient le fruit de mon imagination.
J’ai repris tous mes écrits et je me suis posé la question : qu’est-ce qui relie tout ça ? Où est-ce que je veux en venir ?
Franchement, je ne sais toujours pas, mais je pense que la question tournait autour de la liberté : s’affranchir de ce qui nous empêche d’être vraiment soi. L’éducation ? Les traumatismes ? Le hasard ? Comment être libre ? Est-ce que cette foutue culpabilité n’est pas le plus grand frein à la liberté ? La peur du jugement des autres ? Comment s’affranchir de toutes ces barrières qui nous pourrissent l’existence ? Même si je sais que le bonheur ne doit pas être un but en soi, comment être simplement un peu mieux dans ses baskets ?
Je me suis demandé quel événement pourrait provoquer une crise telle qu’elle me mènerait vers la liberté ? Et c’est là que j’ai imaginé la mort de mon père.
Je me suis dit « si le père d’Adélaïde meurt, elle va tout remettre en question, tout chambouler ».
Je tenais l’élément déclencheur et le liant à tous ces écrits.
J’ai écrit, écrit et encore écrit, parfois avec violence, souvent avec ironie, avec humour mais toujours avec colère, parce qu’Adélaïde était en colère.

La mort de son père la mettait en colère. Pas en colère contre lui mais contre elle-même, son compagnon, sa famille, et contre la vie. Une explosion contre le monde entier. Une remise en question de tous ses choix. Écrire à partir de la mort de son père était comme faire le deuil de toutes ses petites et grandes souffrances. Et en écrivant, je me rendais compte que ses grandes souffrances se révélaient être ses petites et inversement. L’être humain est insondable et moi, la première.
Après l’écriture de ce premier roman, je ne sais toujours pas comment je fonctionne.
Je suis toujours instable mais dans une instabilité heureuse.
De plus, j’ai acquis une certitude : nous sommes tous des êtres instables et donc, ouf, je ne suis pas toute seule. Trop cool. Cela me rassure. Écrire sur moi, c’est écrire sur les autres.
Qui n’a pas eu envie de tout larguer ? De tromper son compagnon ou sa compagne ? De changer radicalement de vie ? D’être quelqu’un d’autre ? De devenir ça ou ça ? Quel mec n’a pas désiré une autre femme ? Quelle femme ou quel homme n’est pas exaspéré·e un moment ou l’autre par sa compagne ou son compagnon ? Pourquoi un couple reste ensemble et un autre non ? Comment un homme, une femme voit sa fille ou son fils qui grandit, qui devient cet être totalement indépendant ? Et les amis dans tout ça ? Vers 16 ans, mes amis ont été ma structure, mon équilibre. C’est encore le cas aujourd’hui. Je place l’amitié sur un piédestal. Pourquoi les voit-on moins ? Est-ce parce qu’on change ?
Tellement de questions et de possibilités de réponses.
Vous me direz que ce sont des problèmes de petits-bourgeois dans ce monde où la souffrance est visible à chaque coin de rue, sur chaque écran de télévision, de tablette ou de smartphone et sur tous simultanément (l’indigestion).
Je ne suis ni une intellectuelle agréée ni une philosophe émérite, simplement une petite poète de ma vie de puceron.
Je fais ce que je sais faire : rêver, imaginer, rire et m’émouvoir, et essayer d’en faire profiter les autres.
Si ceux qui lisent ce roman se souviennent d’un bout de vie d’une humaine qui aurait bien voulu faire de grandes choses et qui, par paresse ou par manque de courage ou à cause d’une éducation chahutée, ne réussit qu’à faire exploser ces émotions, c’est pas mal.
Si ceux qui lisent ce roman sourient, rient, sont interloqués, même un peu choqués et parfois tristes, c’est déjà ça.
Si ceux qui lisent ce roman voient la petite fille et la femme qui évoluent devant eux, alors, j’ai rempli ma mission.
Ce qui peut me blesser, c’est l’indifférence. Je n’aime pas entendre : bof. Je veux des orages. Nos vies sont faites d’orages et il faut qu’ils passent. Ce n’est pas facile de grandir. Mais pour que les orages passent plus vite, mieux se connaître est essentiel et cela permet, selon moi, d’éviter pas mal d’erreurs.
Je parle de l’enfance, je parle d’une enfant, soit, mais, en réalité, je parle des adultes, hommes et femmes.
Des femmes, car je pense que certaines se reconnaîtront en Adélaïde, enfin, j’espère, et des hommes, parce qu’ils reconnaîtront leur femme, leurs sœurs, leurs filles, leurs amies… et leurs emportements, qui ne sont pas de la violence mais plutôt des notes très aiguës jouées sur un piano. Voilà une image pas très explicite et qui mériterait d’être travaillée.
Des pères et des mères, aussi, car ce n’est pas facile d’être parents. Devenir parent, c’est se couper en deux. Une part de nous voue un amour inconditionnel à ces enfants qui nous enverront balader plus rapidement qu’on ne le pense, et l’autre part veut vivre sa vie.

Quand j’écris, parfois, je n’y vais pas de main morte, mais la violence qu’Adélaïde exprime est avant tout envers elle-même. Elle est en colère contre le monde entier et, c’est sûr, cela se répercute sur son entourage. Tous les personnages du roman comptent pour elle, comme ceux qui me les ont inspirés ont compté pour moi.
Maintenant, d’autres thèmes me travaillent, comme la notion du temps, la spiritualité, et même l’environnement (difficile d’y échapper). Or, la spiritualité, qui selon moi commence par la compréhension de soi-même, ouvre des portes insoupçonnées.
Je dis souvent « selon moi », car il est important que ce ne soit pas pris comme si j’annonçais une vérité. C’est la mienne, uniquement la mienne. Mais même ma vérité n’en est pas une. Une fois qu’un événement a eu lieu, c’est du passé, donc, c’est déjà une interprétation. Entre le moment de l’événement, la perception de celui-ci, ensuite l’interprétation de cette perception, la transmission de cette interprétation et la réception, tout a changé.
Le meilleur exemple, c’est la dispute. Une dispute éclate dans un couple à 18 heures. À 18 h 15, elle fait référence à ce qui a été dit à 18 h 05. Il répond que non, ce n’est pas vrai, il n’a pas dit ça ou alors il n’a pas dit ça comme ça. À 20 h 00, ils sont toujours en froid et la tension a monté d’un cran. Ils ont une perception encore différente de ce qui a été dit à 18 h 05. La turbine mentale a déjà fait son travail. Le lendemain, après une bonne nuit de sommeil, les choses se sont un peu calmées. Elle se dit, par exemple, j’ai sans doute exagéré hier…
Et un jour, elle écrit un bouquin et elle se souvient de cette dispute, mais ce n’est pas un souvenir précis, par contre, l’émotion peut ressurgir et donc, elle écrit ce qu’elle ressent de cette émotion et de cette image.

C’est la raison pour laquelle cela m’agace de devoir trancher : autobiographie, récit d’inspiration autobiographique, roman ?
Peu importe, non ? Peu importe ! Moi-même, je ne sais plus ce qui est vrai ou faux. Une fois que c’est couché sur le papier, c’est déjà tronqué. Quand je parle de ma mère qui vient se blottir contre moi dans mon lit parce qu’elle est si triste qu’elle a besoin d’être près de sa fille, c’est un vague souvenir de ma mère qui s’endort près de moi. Donc oui, je pense que ma mère est venue dormir près de moi mais je n’en suis pas tout à fait certaine, et je ne sais même plus pour quelle raison. Par contre, je sais que moi-même, je me suis déjà endormie près de mon enfant et que le réconfort était immédiat. Et là, je peux écrire quelque chose sur la tristesse d’une mère.
Ce qui est périlleux dans l’écriture est, je trouve, de transcrire l’image, les images, en mots.
Je fonctionne essentiellement avec des images. Elles surgissent et sont étroitement liées à une émotion, et la difficulté est de transcrire ce collage image-émotion. Je n’ai pas fait d’études de lettres, je lis beaucoup mais je trouve qu’il est de plus en plus difficile de trouver le vocabulaire approprié, celui qui reflète correctement une idée, un concept, une émotion.
J’ai le sentiment qu’au fil du temps mon vocabulaire s’appauvrit alors que ça devrait être le contraire. J’ai peur qu’un jour arrive où je ne trouve plus les mots.
Que les mots disparaissent définitivement, que nous ne parlions plus qu’avec des signes.
Même si je les utilise, ces fameuses émoticônes, je les déteste.
Car elles nous empêchent de dire : je t’aime, je suis fâchée, j’ai peur, j’ai chaud, j’ai froid, je suis triste. C’est un appauvrissement d’émotions, de sensations et évidemment de vocabulaire.
Par exemple quand je veux dire « Je t’aime », comme je n’ose pas l’écrire, je t’envoie l’image d’un cœur. Mais quand j’envoie l’image de ce cœur, est-ce vraiment : Je t’aime ? Et du coup, comme c’est facile, j’envoie des cœurs à n’importe qui et pour n’importe quoi.

Il faudrait créer le mois sans signes. Il y a bien le mois sans cigarettes ou sans alcool. Je lance le mois sans signes. Je pense que même lorsqu’on écrirait à l’être qu’on aime, Je t’aime deviendrait bien moins fréquent que l’image du cœur. Car quand on écrit Je t’aime, cela veut dire « Je t’aime ». C’est réfléchi, pesé et ensuite écrit.
Et c’est comme ça qu’on en arrive à l’écriture d’une vie fragmentée, romancée et saucée d’émotions.
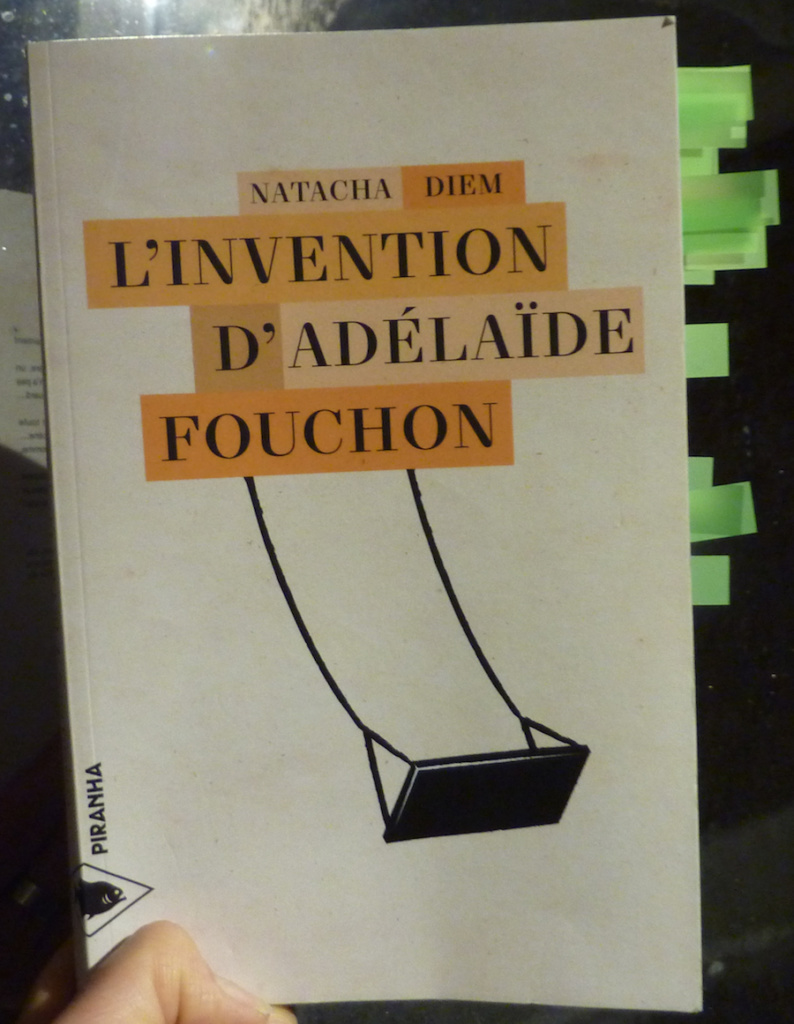
Anne Bouclier, éditrice chez Piranha, raconte…
J’ai un principe, dans la vie : ne jamais, au grand jamais, accepter de lire le manuscrit, ni même le livre, de quelqu’un que je connais, même très vaguement : éditrice ou pas, c’est le début des emmerdements.
Va savoir ce qui m’a pris quand j’ai, de moi-même, dit à ma voisine de terrasse que ça m’intéresserait de lire son texte.
Je la connaissais à peine, et si j’étais assise à portée d’oreille, c’était par hasard. Elle racontait qu’à force d’écrire, elle avait fini par trouver le moyen de réunir certains de ses textes.
Moi, je lisais tranquillement à la table d’à côté, et je ne faisais pas vraiment attention. Mais il y avait quelque chose dans cette voix, le rythme, l’intonation, la précision, l’animation, la musique, en somme, qui m’a attirée.
Et, curieuse comme je suis, j’ai demandé son texte à Natacha Diem, puisque c’est d’elle qu’il s’agit.

Quelques jours plus tard, je m’installe sur mon canapé, manuscrit sur les genoux. Et voilà, c’était fichu…
La voix et la musique de Natacha étaient là, sur le papier, et je les ai savourées avant même d’appréhender l’histoire.
Pourtant, quelle histoire !
C’est l’histoire d’une petite fille qui grandit et qui essaie de trouver sa place. C’est l’histoire d’une jeune femme qui se demande si elle a trouvé sa place, comme cette fille qui veut tout fiche en l’air mais qui se dit : Ah merde, faut que j’aille acheter le pain… Et au bout du compte, c’est, comme le dit Natacha, l’histoire des enfants, des adultes, des parents.
Les femmes se reconnaîtront, et les hommes reconnaîtront leur mère ou leur fille, elle a raison. Et sans nul doute les femmes retrouveront leur père, leur amant et leurs frères, et les hommes se retrouveront.
Quand Adélaïde se souvient, ce que nous voyons et ce que nous entendons, c’est ce que voit et entend un gamin de quatre-vingts centimètres perdu au milieu d’adultes d’un mètre quatre-vingts, lesquels ont leur propre perception de ce qu’ils ont dit, et de ce que le gamin en question a compris.
Et le talent de Natacha, c’est justement d’alterner les points de vue et les registres, de passer du passé au présent, de l’enfance à l’âge adulte, de la narration à l’introspection, du trivial au poétique.
J’ai été séduite, ravie, par sa capacité de passer, pratiquement dans la même phrase, naturellement, spontanément, d’une langue douce et subtile à une langue crue et incisive, de l’attendrissement à la colère, de la finesse au cocasse.
J’ai frissonné et j’ai éclaté de rire dans la foulée.
La musique de Natacha sonne terriblement juste, et le « je » d’Adélaïde est le « je » de Marcel, il est universel.
Et c’est comme ça que Piranha a décidé qu’il était tout à fait possible de publier un roman qui n’était pas une traduction [les éditions Piranha publiant essentiellement de la littérature étrangère, donc traduite à destination du public francophone].
L’Invention d’Adélaïde Fouchon, roman, par Natacha Diem, aux éditions Piranha, 18 euros.
Infos & Réseaux :
Instagram :
@natacha_diem
@edpiranha
Facebook :
Natacha Diem
@editionspiranha
Twitter :
@DiemNatacha
@PiranhaEditions
Site : piranha.fr
Piranha sur Calaméo
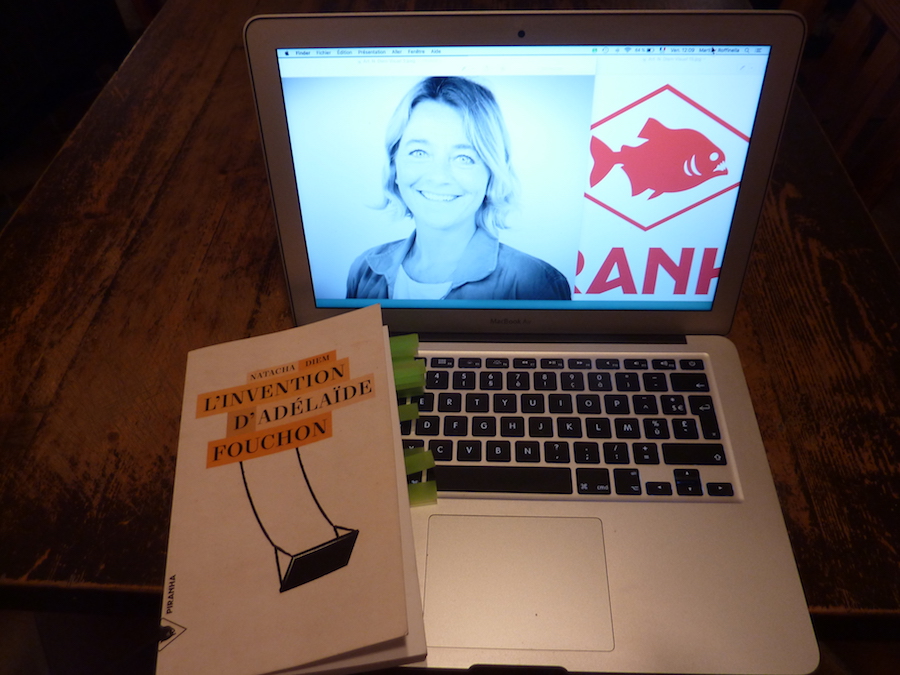
à qui sait le reconnaître, le sentir, chacun.e a un enfant greffé dans sa jambe. L’enfant que l’on fût. Son esprit est l’écriture, la poésie qui continue à s’animer dans notre corps d’adulte, et que l’on perçoit à certaines saisons de la vie quand on est est seul ou le devient. L’enfant que l’on fût demeure à jamais là, greffé dans la naissance de chacun de nos pas … Michel Del Castillo l’évoqua à travers l’un de ses romans. L’image m’est restée forte et essentielle. Je la retrouve ici, sous les strates d’une sensibilité extraordinaire. Aimez chère auteure, cette enfant qui vous accompagne sous la peau ! Erik Poulet-Reney
Bonsoir Erik,
Merci du fond du cœur pour ce commentaire. J’aime beaucoup le mot strate, tellement juste. Et merci d’ajouter une réflexion supplémentaire à ces intenses questionnements qui font de nous ces humains si complexes. Merci Natacha Diem
Sans doute est-ce le livre qu’il me faut lire aujourd’hui, à ce moment incertain où les mots ont mis leur masque d’imprimerie. Et où j’ ai le projet de tout lâcher.
Cette présentation spontanée et sereine, pleine de vie et d’intelligence me touche et me rappelle que dans un temps pas si lointain ( hum) j’ aurais pu, voulu, l’écrire.
Et ce magique conte de fée éditorial vient confirmer que le hasard fait bien les choses.
Votre commentaire est beau et triste à la fois. Bien sûr, il est parfois plus simple de se dire: je lâche tout mais c’est à ce moment qu’il faut lâcher sans tout lâcher. Lâcher ses émotions auprès des personnes bienveillantes qui nous entourent, parler, pleurer, crier, et écrire, toujours écrire. Comme je le dis dans mon interview, nous sommes tous des pucerons sur cette belle planète et personnellement, quand j’en prends vraiment conscience, je me sens beaucoup mieux et moins triste. Les personnes qui ne sont jamais tristes n’ont rien compris à la vie. Il faut être triste, même très triste, ça fait du bien. Encore un cliché mais j’ai toujours dit à mes enfants de pleurer. Ce sont deux garçons et j’aime les voir pleurer car quand ils sont tristes, je sais qu’ils vivent! Je ne veux pas de garçons-machines qui ne montrent pas leur sentiment. Alors, excusez-moi mais évidement, je ne suis pas heureuse que vous soyez triste mais je suis heureuse que vous en parliez. On ne se connaît pas mais je suis de tout cœur avec vous.
Natacha Diem
merci,et bonne journée
Le résumé et les deux voix, auteure et éditrice, me donnent vraiment envie de lire ce livre tellement il résonne fort en moi. J’ai hâte de me le procurer et de le savourer. Enfant, j’étais aussi en permanence obligée de mentir et de m’inventer des personnages/personnalités pour survivre et me construire tant bien que mal. Je suis vraiment ravie pour cette découverte que Martine Roffinella a mise en lumière sur son site. Amicalement, Micha
Bonjour,
C’est ce qui me semble remarquable dans ce texte : chacun et chacune s’y retrouvent, d’une manière ou d’une autre. Nous sommes reconnaissantes à Martine de nous avoir donné l’occasion d’en parler, et votre commentaire nous touche.
Anne