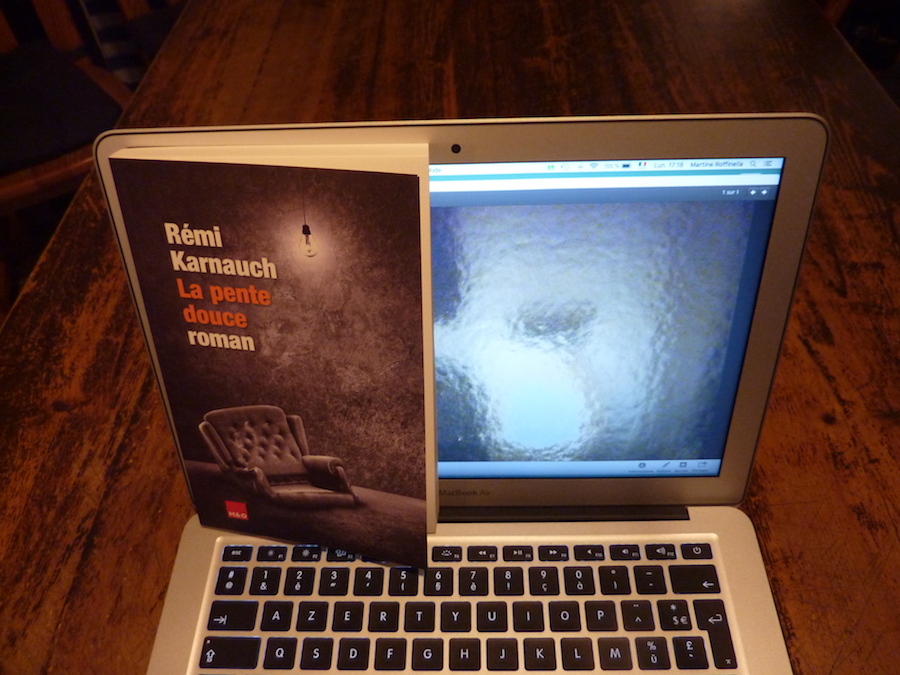« La situation pouvait donc se résumer ainsi : mon père meurt, ma chérie m’a largué. L’un veut que je l’assiste, l’autre que je n’insiste pas. J’ai tenu bon, disant à l’un, à l’autre que je n’obéirais pas. » S’apercevant que sa vie l’a « abandonné depuis vingt-trois ans », Théo entreprend une marche « en lisière de [sa] réalité », sans cesse ramené sur la bande d’arrêt d’urgence de ses fêlures.
« Pendant quelques instants, j’ai couru le long de la bande d’arrêt d’urgence. Au fond la situation était simple. Tu allais mourir ici, là-bas, sur cette autoroute, dans cet hôpital. J’allais survivre ici, chez moi » – l’affaire paraît somme toute commune, s’agissant de la mort d’un père, qui vient ici violemment caramboler Théo Fléole.
Sauf qu’en l’occurrence, Théo a « dû laisser passer » près de vingt-trois ans après cet événement, soit un « président, un septennat, un autre, un quinquennat, un autre », et aussi un « stage rémunéré (…), un CDD. Un licenciement. Le RMI, le RSA, la CMU, les Assedic. Un héritage : ma mère, si j’ai bonne mémoire ».
Il ne lui est pas « arrivé grand-chose » ; simplement ses « cheveux sont tombés, [son] ventre a poussé, [ses] rides ont essaimé, [ses] dents se sont gâtées ».

Comprenant que la mort de son père l’a « perturbé » au point d’avoir « mélangé les épisodes et les images » de sa vie et de son amour qui l’ont « abandonné » ensemble il y a vingt-trois ans, Théo se demande comment il a pu « laisser passer cela sans avoir jamais rien tenté » pour « reconquérir » celle qu’il nomme A.-M. P.
Il décide donc d’agir « sans tarder » et part pour Rouen, car « on » lui a dit que son « ex » est « revenue travailler sur les lieux de [leur] rencontre », laquelle s’est produite dans cette ville « en avril 1988, peut-être en mai, ou en 90 ».
Et peu à peu, Théo se dit qu’il lui reste « une seule chose à faire : réunir les éléments [le] conduisant jusqu’à l’endroit secret où l’amour de [sa] vie l’atten[d] » – car « à force de tailler un chemin et d’avancer dessus », il pense « qu’un battement de paupière » va « faire émerger celle qui d[oit] savoir à tout prix » qu’il est « encore vivant ».
Alors il marche. Il marche inlassablement dans cette « campagne normande » ; il court, même, « le long d’une sente éclairée par [ses] joues luisantes », croyant « cueillir » son amour d’antan « par surprise ». Mais elle « s’est aussitôt échappée » – « sa fuite légère, son absence si lourde reprenait son cours régulier et puissant. L’ombre coulait, la nuit s’insinuait, par petits seaux – puis des abreuvoirs entiers jetés au crépuscule ».
« C’est moi Théo, je voudrais te revoir, juste te parler », griffonne-t-il sur une « feuille volante » qu’il fait porter à la belle – alors que pourtant il tourne les talons, « [s’] éloignant pour ne pas [se] faire repérer par celle qu’[il] préten[d] vouloir retrouver ».
Car, dit-il, « une étrange faiblesse m’avait saisi » et « mes jambes ne portaient plus qu’un corps victime de l’attraction de la gravité, penchant dont je ne pouvais me défaire, n’ayant jamais été un de ces types légers qui sautillent à la surface de la planète en rigolant ».
Mais quelle forme de prise Théo peut-il bien avoir sur ce présent qu’aucun échafaudage sûr ne vient consolider ? La femme qu’il veut retrouver l’a « largué », et la chute de vingt ans qui en a été la conséquence ne lui permet que d’« atterrir aux lieux de [sa] défaite un peu abruti en quelque sorte ». Et à « l’arrivée, plus rien ne coïncidait. Ni sa falaise ni les vagues mourantes où j’étais venu cogner n’y changeraient rien ».

Théo marche « toujours », croyant « atteindre le moment où l’abrutissement nous délivre d’un monde sordide », mais se retrouvant inexorablement « au milieu de ce piège, à savoir l’autoroute de Normandie » – « m’avait-il suffi d’une simple erreur d’appréciation pour m’enfoncer peu à peu dans la nuit de cette autoroute et me perdre dans un engrenage à ciel ouvert ? »
Peut-on revoir un grand amour sans pour autant « régler des comptes » ?
Théo veut « juste comprendre », alors que A.-M. P. se « rebiffe », au café des Bons Copains où ils se retrouvent enfin.
« D’après toi », dit Théo, « j’étais devenu un type amer qui voyait le mal partout sans tenir compte de l’envers des faiblesses humaines. Un type pas généreux qui accommode ses lubies en ignorant l’évolution des autres » – « un type enlisé dans sa jeunesse dont la tête d’iguane clignotait au ras de ses regrets ».
Et cette A.-M. P. – qui vingt-trois ans plus tôt était capable de réinventer les arbres, les rivières, et même les elfes, elle qui pouvait « laisser filtrer la beauté du monde » et la restituer à Théo simplement en le regardant, « à demi sommeillante », un peu « inquiète mais rendue vivante par l’aventure » –, qu’est-elle devenue ?
Elle a « trouvé le soupirail où faufiler [son] corps nerveux » et s’est « accrochée à des pitons bien plus concluants » ; est « heureuse à présent » qu’elle a « deux petits gars » (les « chiards », dit Théo) et qu’elle peut « discuter avec des gens normaux, pas comme ceux qui d’un serpent python se faisaient les compagnons solitaires ».
Que donnera cette confrontation ? « Une déception, du vacarme, de la baston » ?
J’invite chacune et chacun à le découvrir, en empruntant La pente douce que le talentueux Rémi Karnauch nous propose – tremplin vers notre propre intériorité –, dans un style tout à la fois enchanteur, démoniaque, subtilement ironique, impitoyablement drôle, sur un rythme poético-musical à couper le souffle (ou à le retenir).

Quatre questions à Rémi Karnauch
MARTINE ROFFINELLA : Comment se lance-t-on dans la conception d’un tel ouvrage ? Avez-vous mûrement réfléchi au sujet, ou bien vous êtes-vous engagé dans ce « road movie intimiste » tête baissée, vous laissant porter par le mouvement multidirectionnel et baroque de l’écriture ?
RÉMI KARNAUCH : Ce roman provient d’un long poème en prose, où un sujet s’est peu à peu dégagé, il y a eu plusieurs étapes, une façon de revenir au réel après tant d’années. D’une certaine manière, c’est aussi ce que raconte ce livre : un espoir de ressusciter, de croire que l’on n’a pas vécu en vain, mais la rencontre dans le temps est impossible, la sensation se dérobe. C’est peut-être cela qui fait écrire…
M. R. : La mort du père, venant percuter Théo de « plein fouet », génère une vaste prise de conscience qui, pour tout un chacun d’ailleurs, peut amener aux confins de la folie. Il n’empêche que c’est vers l’amour – « cette femme dont j’ai chéri les courbes et les langueurs » – que Théo se porte. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce parti pris, cette quête ?
R. K. : La mort des parents nous conduit vers notre dernière ligne droite. Plus moyen de ruser. Plus de garde-fou… sauf que ce père, celui de mon récit, ne protégeait pas réellement de la folie. Dans la réalité, quand mon père est mort, j’ai écrit en un temps record un roman Dos au mur, et c’était un roman presque comique – puisqu’il n’y a plus rien, allons-y… Il faut noter que, dos au mur, on ne va pas loin… Là, le narrateur, se croyant libéré de l’entrave paternelle, tente de s’arracher à son immobilité, il remonte le cours d’un souvenir, il veut sauver les meubles, c’est trop tard, il peut regretter de ne pas s’être réconcilié avec ses parents, avec la société, il est trop tard pour être lucide, alors il fait n’importe quoi, il s’enfonce dans un piège, il se débat…
M. R. : Nous croisons dans ce récit toutes sortes de mondes et de langages, comme si Théo faisait partie de tous et d’aucun à la fois, lui qui se juge « touriste de la cloche », « espion de la débine », « fils de bonne famille jouant au petit zonard ». Quelle était votre intention d’auteur ? Et comment définiriez-vous la place de Théo (ou sa non-place) dans la société contemporaine ?
R. K. : Théo est un déclassé. Un bourgeois déclassé, mais aussi un clochard déclassé. Il n’intègre aucun monde et se fond dans le décor, emprunte à tous les langages quelques codes. Théo, Théodore, M. Fléole fait un retour vers ses années 80. Il a vécu la zone de ces années-là, une zone ordinaire, celle de l’ennui. Ce personnage se sent un imposteur où qu’il se trouve. Il joue au pauvre, mais il n’est pas un fils de pauvre, il est le fils d’un immigré russe, qui est parvenu à s’insérer dans le monde, à gagner de l’argent. Ce père pourtant était un idéaliste et il est trop facile de s’en moquer, de l’attaquer. Le narrateur est pris par le remords, par le regret, il voudrait parfois réparer, à d’autres moments la colère le prend, et il boxe les fantômes… il aime les fantômes, il aime encore ce fantôme, une femme, il se rappelle cette sensation si rare, si neuve… il n’arrive jamais, plus jamais à aborder le réel, c’est cela qui le fait cavaler. Il ne tient pas en place.
M. R. : Comment travaillez-vous votre style, qui parvient à combiner si remarquablement l’ironie, l’humour, l’audace, la poésie, ainsi que cette appréciation inventive, un rien insolente donc politiquement incorrecte, de l’existence humaine ? Il y a notamment cette respiration qui vous est si spécifique (déjà remarquée dans Honoré Laragne) : de quelle façon la mettez-vous en place ? À moins que tout cela vous soit totalement naturel ?…
R. K. : Le rythme est très important. Je travaille énormément à l’oreille, mais le tempo parfait se dérobe, la métrique en prose est aléatoire, alors je recommence… Quand il me vient des trouvailles, je suis content, je vois quand même un peu l’écriture comme une aventure, une aire de combat où se retrouver, un duel entre soi et soi, mais aussi un endroit de pure fantaisie où lâcher les chevaux, se libérer de la forme et y revenir tout le temps, ne jamais essayer d’être drôle tout en étant si content d’avoir trouvé une idée marrante, s’échapper du sens, et soudain dire les choses clair et net…
La pente douce, roman, par Rémi Karnauch, chez H&O éditions, 16 euros.