Racisme, viol et injustice côtoient fantasmagorie, légendes et épopée de l’enfance dans une histoire dont Tiffany McDaniel précise qu’elle est inspirée de la vie de sa famille. Betty dite « Petite Indienne », que nous suivons sans presque respirer pendant 716 pages, est sa mère.
La magie de ce grand roman aux légendes si naturellement vraies réside, comme pour toute belle œuvre, dans la possibilité de le lire chacun·e pour soi, en fonction de sa propre histoire, de son âge, de son sexe, de sa couleur de peau.
Oui, chaque lect·rice·eur aura sans doute sa propre idée du thème majeur qui se dégage de Betty. D’aucuns diront que les femmes en sont les héroïnes, d’autres encore que c’est le père – Landon Carpenter, Cherokee, qui en est la figure marquante. À moins que le sujet réel ne soit le racisme, cruellement exprimé, à l’égard des Indiens et des métis. Ou encore les conditions économiques funambulesques, la précarité constante, l’immuable tyrannie des hommes, la ségrégation dans les écoles, les violences de tous ordres, l’inceste, la vie malgré et contre tout, la puissance ou la nuisance du rêve, etc.
Il ne faut pourtant pas, à mon sens, séparer ou même identifier tous ces gisements. À l’image des poupées gigognes, ce livre se désemboîte à chaque chapitre. Ce que nous avons appris est certes matérialisé dans notre mémoire, mais il faut poser cet acquis et reprendre l’aventure avec la poupée qui était glissée dans la précédente. Pour peu à peu glisser vers l’unique et toute petite personne principale – celle que nous garderons à jamais dans notre cœur et qui reviendra souventesfois s’infiltrer dans nos pensées.

Si Betty Carpenter, « née dans une baignoire » d’une mère blanche et d’un père cherokee, est celle qui détient en quelque sorte l’histoire et nous la livre avec son je narratif, chaque personnage croisé, même brièvement, est un livre à lui seul – ou la possibilité d’un conte, d’une nouvelle.
La petite ville de Breathed, dans l’Ohio, où la famille s’installe, est elle-même un univers qui paraît distinct de la Terre sans en être le satellite – au contraire, l’impression ressentie est que toute vie ailleurs qu’à Breathed est secondaire, annexe.
Extrait, page 83.
BIENVENUE À BREATHED était peint en rouge sur un morceau de planche fendillée cloué à un platane d’Amérique. Avec le temps, j’allais apprendre que, quelque part entre le paradis et l’enfer, Breathed était une parcelle de terre nichée au cœur d’une douleur lancinante, où les lézards se faisaient écraser sous les roues et où, quand les gens parlaient, on croyait entendre le tonnerre racler le tonnerre. Dans ce coin du sud-est de l’Ohio, on se réveillait aux aboiements de chiens errants en ayant conscience que l’ombre de loups plus gros n’était jamais bien loin.
L’histoire de la maison où les Carpenter emménagent est elle aussi un roman tiré d’un fait divers non élucidé – quoi de plus logique pour un père dont presque chaque parole est une invitation à l’imaginaire tenu pour vrai et qui en plus est une « véritable encyclopédie des plantes » ?
Betty est la sixième des huit enfants, c’est elle qui nous guide dans leur vie « en marge de la société », car sa mère blanche a épousé un Cherokee en 1938. Dans ces années-là et bien après, les Blancs estiment que « les gens de couleur ont toujours une maladie ou une autre », et qu’il ne faut plus toucher un objet qu’ils ont eu entre les mains, car ils auront mis leurs « microbes dessus ».

Même (et surtout) à l’école, les enseignants cultivent une ségrégation et un racisme considérés comme allant de soi – au point que Flossie, l’une des sœurs de Betty moins « typée » qu’elle, refuse d’être vue en sa compagnie – « Je peux pas te laisser plomber mon image comme ça », lui lance-t-elle sans ciller.
La maîtresse affirme d’ailleurs que si Betty a la peau foncée, c’est qu’elle est « sournoise », « du genre fourbe », et qu’elle « se passe de la graisse sur la peau », restant « assise toute la journée au soleil à ne rien faire ».
Cette même institutrice explique tranquillement à toute la classe ce qu’est « l’hybridation » – « c’est comme si on mélangeait des échardes de bois à du lait et qu’on le vendait au public ». Et de conclure par cette question : « Tu aurais envie de boire une bouteille de lait qui contiendrait des échardes, Betty ? »
Ainsi parlent les enseignants à une fillette qu’ils traitent de « petite squaw » tout en reprochant à l’ensemble de ses « semblables » d’être des « échardes » dans le « bon lait frais, crémeux et sain » des Blancs.
Après cela, Betty subira toutes sortes d’humiliations, y compris physiques, de la part d’adultes aussitôt imités par les enfants qui la traiteront de « singe » et lui descendront de force sa culotte pour voir si elle a « une queue » tel un animal.

La/le lect·rice·eur peut alors se demander si ce mariage entre une Blanche (Alka) et un Cherokee (Landon) est d’amour – le révéler ici serait briser le principe du roman gigogne évoqué plus haut et du coup éclipserait la découverte progressive des éléments clés imbriqués les uns aux autres et reliés à des dizaines de vies.
La force du livre de Tiffany McDaniel puise précisément sa source dans cette impossibilité d’isoler un événement et de l’ériger en cause, car des centaines d’autres faits peuvent aussi revendiquer leur importance majeure et expliquer les nombreux basculements de destinée auxquels nous assistons – non pas impuissant·e·s devant une page imprimée, mais tel·le·s des ami·e·s glissé·e·s dans l’ouvrage, voire des membres de cette famille qui pour moi est un trésor.
Sans trahir le cœur du roman, je peux simplement dire que le viol d’enfant en constitue le sang. Et ce sang gicle sur les chapitres à plusieurs reprises, il paraît même s’auto-régénérer pour y poser ses gouttes ou poursuivre en ruisseau sa lignée de drames – de viols encore.
Betty pourrait être le symbole d’une sorte de résistance au malheur, mais elle n’incarne pas cette héroïne-là. Elle écrit. Elle enfouit des histoires qu’un jour elle sortira de leur prison de verre et de terre – y compris celle de sa propre mère, Alka, quand, enfant de huit ans à peine, elle « glisse » sur son sang (encore), elle plaque ses poignets tailladés contre sa poitrine, elle sent ses mains « pareilles à celles d’une poupée de chiffon », la couleur du sang de sa mère lui rappelant « les betteraves qu’elle [lui] avait demandé d’aller arracher le matin même ».

Betty, c’est aussi le roman d’une fratrie – Flossie qui veut « devenir une star et vivre à Hollywood et être plus célèbre qu’Elizabeth Taylor », Trustin qui dessine sa solitude, la secrète Fraya qui confie ses prières à l’aigle pour qu’il les emporte jusqu’à Dieu, Lint qui pense que « les f-f-fées » l’ont « m-m-mordu » car elles ont des « d-d-dents coupantes co-co-comme des couteaux », Leland qui a les mêmes yeux que le père d’Alka et qui met « de la boue sur la couverture de Fraya »… aucun ne peut être considéré comme un personnage de fiction, et dans le même temps, la/le lect·rice·eur pense les rêver, les croiser dans sa propre réalité, même (et surtout) le livre refermé.
« Petite Indienne » paraît souvent les avoir tous en responsabilité – elle est leur réceptacle, son écriture rend compte d’eux : anges ou monstres, elle est leur preuve de vie.
Témoin de l’histoire saccagée de sa mère, Betty est aussi celui de la culture cherokee, jusqu’au « clan Aniwodi » (qui fabriquait « une peinture rouge spéciale » utilisée lors des cérémonies sacrées »), que son père Landon Carpenter, né en 1909 « dans un champ de sorgho du Kentucky », lui transmet de vive voix à chaque occasion.
Extrait, page 25.
Notre clan était celui des créateurs, me disait mon père. Celui des maîtres, également. Ils parlaient de la vie et de la mort, du feu sacré qui éclaire tout. Notre peuple est le gardien de ce savoir. N’oublie jamais cela, Betty. N’oublie jamais non plus comment fabriquer de la peinture rouge, ni comment parler des feux sacrés.
Betty est l’organe même de la transmission – de ce qui fut souffrance et horreur, mais aussi de ce précieux lien à la Nature et à l’âme de toute chose que lui enseigne Landon.
Responsabilité trop douloureuse ? Oui sans doute – l’un de ses jeunes frères en paiera le lourd tribut. Mais quel autre choix y avait-il, quand une culture doit à tout prix être sauvée de l’oubli et qu’en même temps, c’est sa confrontation à celle des Blancs qui rend la mémoire de la jeune Betty déjà si dramatiquement ensanglantée ?
Pour vous faire votre propre avis, je ne peux que vous inviter à vous précipiter sur ce grand roman gigogne et à partager ensuite ici vos impressions.
En guise de conclusion, ou plutôt d’ouverture, une des paroles de Landon Carpenter à méditer et à se garder pour les jours de vent mauvais, c’est-à-dire assez souvent ces derniers temps.
Extrait, page 113.
Tout ce dont nous avons besoin pour vivre une vie aussi longue que ce qui nous est accordé nous a été donné dans la nature. Ça ne signifie pas que si vous mangez telle ou telle plante vous ne mourrez jamais, car la plante elle-même mourra un jour, et vous n’avez rien de plus qu’elle. Tout ce que nous pouvons faire, c’est guérir ce qui peut l’être et apaiser les souffrances causées par ce qui ne peut pas l’être. En tout cas, nous apportons la terre en nous et entretenons la conscience que même la plus petite feuille a une âme.
Betty, roman, par Tiffany McDaniel, paru aux éditions Gallmeister, 26,40 euros.
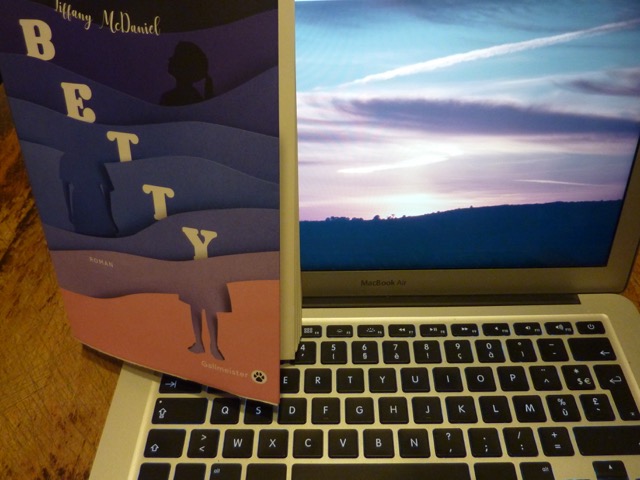

Dans ma cosmogonie intime, Betty a l’oeil gauche de Simone Weil ( la philosophe) & l’oeil droit de Toni Morrison, montés des lunettes de Roffi, ce qui donne une envie de s’y jeter à regards perdus, éperdus… Merci de cet article vivant en diable & frappé d’âme…