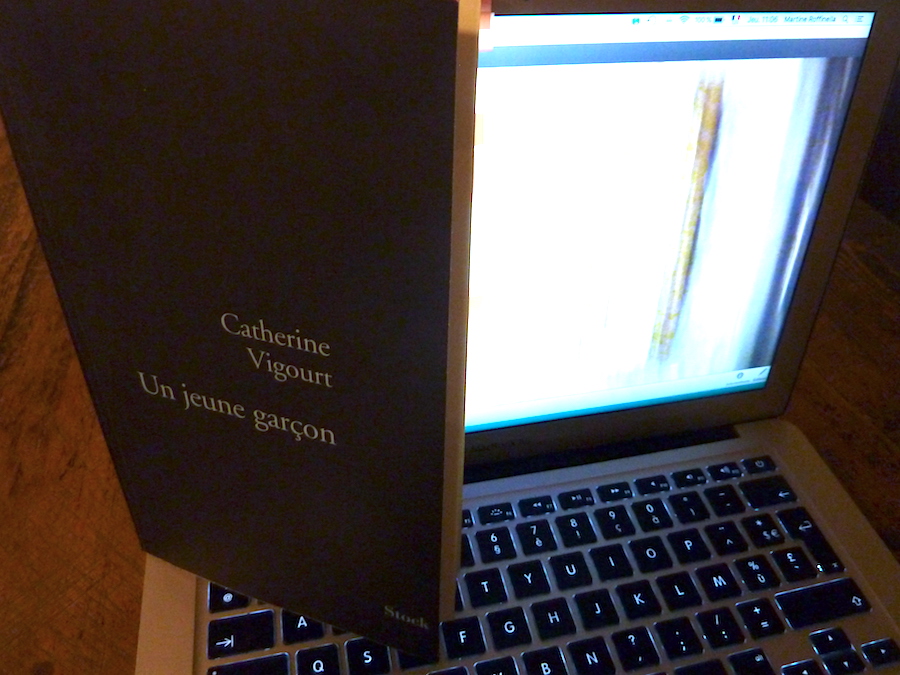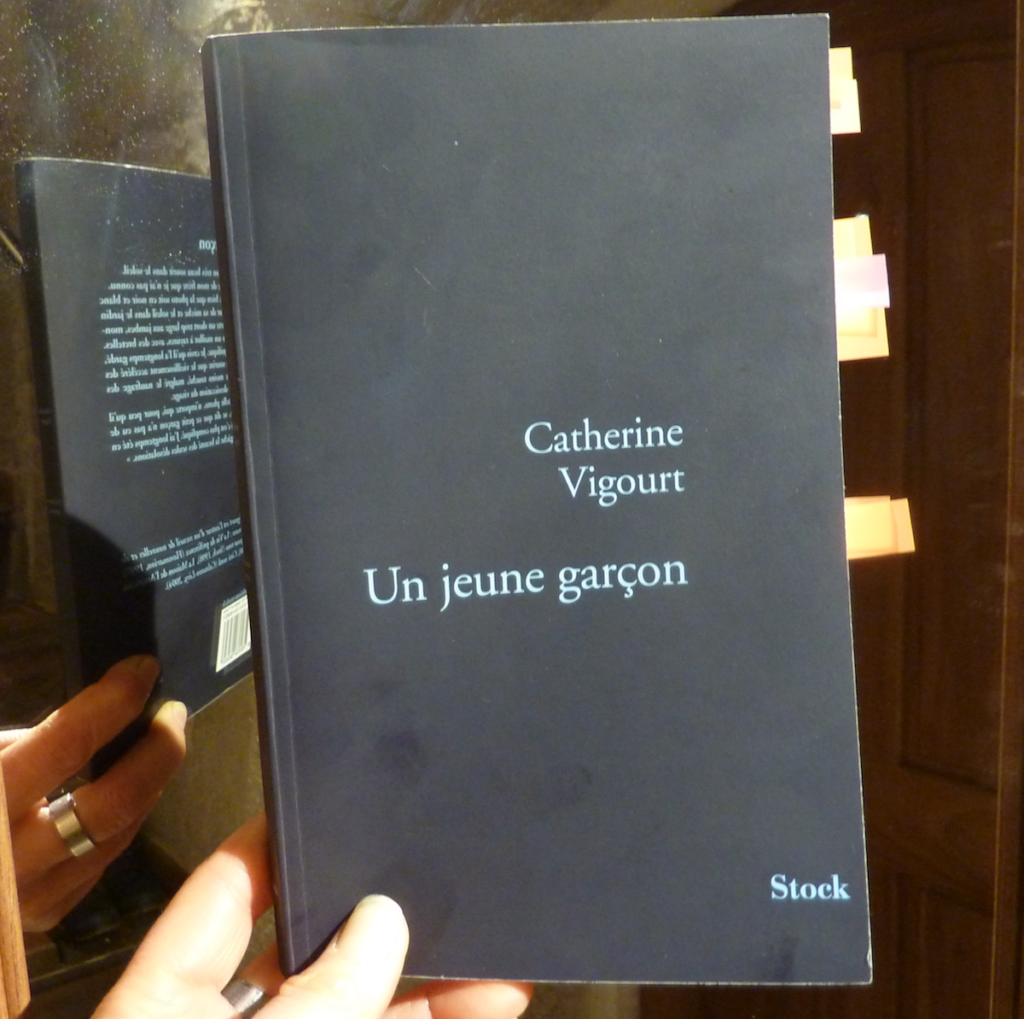Il y a un avant et un après la découverte d’Un jeune garçon. L’impressionnant « corps à corps » littéraire que Catherine Vigourt engage avec son propre texte, sans jamais recourir à la sensiblerie ni céder aux sirènes du pathos, force l’admiration et tirebouchonne la peau du cœur.
« Un jeune garçon, très beau, sourit dans le soleil », nous annonce la première page – mais pas le temps de se réchauffer à cette image faussement avenante : en quelques phrases nous savons qu’il est mort, et que celle qui parle est sa sœur, plus jeune de dix ans.
Et « les conneries qu’il a faites », dit-elle, « j’en ai essuyé un bon nombre ».
Nous apprenons dans la foulée, sans une syllabe de trop – comme si la narratrice se tenait à distance de ses propres mots –, que l’enterrement de ce frère a eu lieu.
Elle se souvient, en vidant l’appartement, d’« avoir jeté par sac-poubelles entiers des boîtes de Subutex qu’il cachait partout ».

Très vite le récit nous avale dans une sorte de stupéfaction qui ne nous laisse ni le loisir ni l’envie de nous épancher : de lect.rices.eurs nous devenons des témoins-clés, chargé.e.s par Catherine Vigourt de mémoriser cette histoire-là afin qu’elle-même s’y (re)crée en tant qu’écrivaine.
La narratrice n’a « jamais eu de goût pour [s]on enfance » ; présentement elle doit « défroisser un vieux pli qui résiste et qui blesse ».
Nous faisons ainsi connaissance d’Alain et de sa famille, dans un style dépouillé et puissant, grave mais preste, qui ne s’appesantit jamais et dont chaque silence fait mouche – pichenette ou coup de poing alors que la phrase semble baguenauder entre les aspérités possibles de son sujet, poignante à son insu, dirait-on.
Mais ne nous y trompons pas : l’autrice connaît bien son embarcation, elle tient la barre du récit avec une redoutable précision qui mêle poésie et l’ultraréalisme d’un constat : ce frère et cette sœur sont « sans fraternité ».

Très tôt dans la drogue (d’abord les « pétards » puis des « produits plus sévères »), atteint de schizophrénie, « il est le frère aux cent pas » qui arpente l’appartement familial « dans une djellaba bleue dont il prétend que Rimbaud portait la même dans les déserts d’Abyssinie » – poursuivant son entourage de ses « mots en meute », menaçant une fois de « se châtrer » avec un couteau de cuisine, hurlant et traitant son père de « chien de fasciste ».
Il n’épargne pas sa jeune sœur, lui lançant par exemple au visage un cendrier de verre qu’elle « évite de justesse » – « Alain distribue des claques qui tombent où elles peuvent […] Il faut tenir bon ne pas glapir ne pas couiner ne pas quitter le terrain, merde, merde », car « ici tous les terrains sont les siens », il envoie « ses taloches » ; son trench-coat à elle est « couvert de sang ».
La mosaïque de cette enfance-là vient coïncider avec le temps de la disparition : « Hôpital Mondor, février 2002. Mon frère est mort en service de réanimation » – « pas la moindre larme, mais la sensation d’un gâchis de misère », au point que la narratrice voudrait « qu’il n’ait pas vécu pour n’avoir pas eu à mourir ».

Abus en tous genres, mise à sac au long cours du tissu familial, violence et récurrence des crises de schizophrénie, trafic de drogue, séjour en prison, etc. : à partir de quelle dose les circonstances atténuantes perdent-elles toute pertinence ?
« Mon frère. Un jour j’ai eu envie de le jeter à l’eau.
Je n’en reviens pas de ne pas l’avoir fait […] Deux temps, trois mouvements. J’imagine son poids sonore ouvrant l’eau en contrebas […] Une mort à portée de main, de mes mains à moi […] Ce serait le moment […] L’instant rêvé. L’événement parfait. »
Quelle conséquence ou substance l’incroyable écrivaine qu’est Catherine Vigourt tire de cet « assassinat frôlé » (qui est « quand même un assassinat ») ?
Je vous invite, avec beaucoup d’insistance, à vous plonger sans tarder dans Un jeune garçon qui, dépassant et de loin une histoire personnelle, ouvre le champ de l’acceptation de soi, dans la bonté et dans l’horreur – et au fond, « heureusement que le présent est là : la belle violence des instants donnés ».
En toile de fond – et pas des moindres –, la génération de Mai-68, « l’impression d’un chahut d’enfants gâtés qui aurait mal tourné. Pas assez mal tourné non plus pour devenir héroïque ».
EXTRAIT (pp. 154-155) :
« Chaque fois que je passe sur le boulevard qui longe le périphérique, je longe aussi ce que j’étais ce soir de l’enterrement. Une sœur qui venait d’enterrer son frère, qui n’avait pas le chagrin qu’il faut, qui n’était pas dans le lieu qu’il faut. Là, le bruit, le mouvement, la chair, la lumière, la parole. En face, la nuit radicale, l’immobilité, le silence, le désert, la pierre. Entre les deux, le ruissellement rouge des voitures.
Et je crois au bout du compte être venue à cette soirée justement parce qu’elle se donnait là, à cet endroit. Ce que j’allais chercher près de la fenêtre, je ne l’aurais trouvé nulle part ailleurs : un cercle de vie tout près d’un carré mort, juste au bord d’une ligne infernale. J’étais restée du bon côté. »
Un jeune garçon, par Catherine Vigourt, est publié aux éditions Stock (18 euros).
Catherine Vigourt sera dans quelques semaines l’invitée exceptionnelle de mon blog, dans le cadre d’une nouvelle rubrique réservée aux femmes et intitulée : « Coup de chapeau à ».