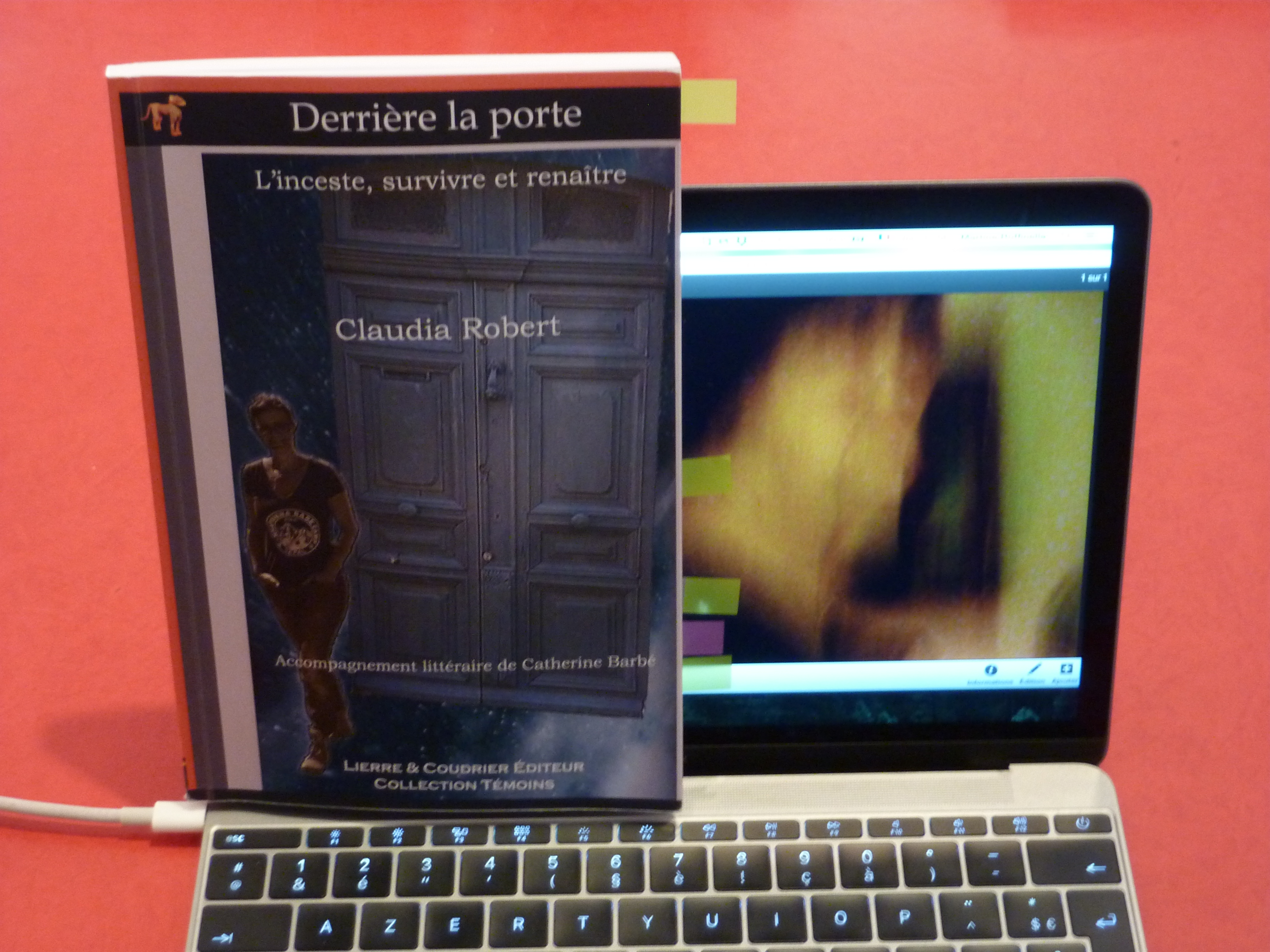« Finalement, je crois que ce qui est le plus dur à vivre avec l’inceste, c’est le cadavre qui reste à l’intérieur de soi », ce « fardeau invisible » qui vient inexorablement alourdir le corps et l’âme, explique Claudia Robert dans son livre « Derrière la porte ». Parcours à vif d’une femme « mutilée mais vivante ».
Au commencement il y a un père ambitieux, « véritable bosseur », « fonctionnaire dans les chemins de fer », qui veut « gravir les échelons pour aller toujours plus haut ».
La mère est au foyer, gérant tant bien que mal sa « famille nombreuse » (quatre enfants, dont un handicapé moteur cérébral).
La vie aurait pu, tout compte fait, être « bercée par un bonheur simple ».
Mais pour Claudia, à l’âge de quatre ans tout bascule. « Tonton » (frère de sa mère) entraîne celle qui n’est encore qu’une fillette dans la buanderie, pour voir sa « petite culotte » puis « fouiller » son « vagin », pendant que de « sa bouche atrophiée », il souille irrémédiablement la peau de sa jeune victime avec ses « résidus de bave visqueuse ».
Te souviens-tu du pantin que tu as laissé derrière toi en partant ? lance Claudia à cet oncle « violeur d’enfant », cette « bête impure » et « affamée de chair ».
 Les années passent, rien ne semble pouvoir interrompre la succession des « nuits d’angoisse et de terreur » où les « gros doigts » de cet oncle pervers ruinent le corps de l’enfant, son sexe s’enfonçant dans sa bouche, dévastant Claudia au point que son esprit n’est bientôt plus qu’un « amas fracassé ». Elle essaie bien de prévenir sa mère mais ne recueille qu’un rire – qui « n’en finit pas » et qui la « transperce », la laissant seule avec « son poignard dans le dos ».
Les années passent, rien ne semble pouvoir interrompre la succession des « nuits d’angoisse et de terreur » où les « gros doigts » de cet oncle pervers ruinent le corps de l’enfant, son sexe s’enfonçant dans sa bouche, dévastant Claudia au point que son esprit n’est bientôt plus qu’un « amas fracassé ». Elle essaie bien de prévenir sa mère mais ne recueille qu’un rire – qui « n’en finit pas » et qui la « transperce », la laissant seule avec « son poignard dans le dos ».
Les « appels au secours restent sans issue ».
Claudia subira d’autres outrages, notamment de la part de son frère – au point de se demander si elle n’est pas « née pour être un objet sexuel ». Elle en vient à rester « passive », comme « anesthésiée ». « C’est ainsi, c’est écrit », pense-t-elle.
Est-il possible de se reconstruire quand on a été abusée dès l’âge de 4 ans et jusqu’à 16 ans ? Peut-on « survivre » à cette mutilation, cette amputation du « droit au bonheur » ?
Lisez Derrière la porte, belle leçon de vie, message d’amour et d’espoir pour toute personne passée par cet enfer et qui espère « renouer avec soi-même » – s’emparer du mot liberté.
 Quatre questions à Claudia Robert
Quatre questions à Claudia Robert
MARTINE ROFFINELLA : Racontez-nous la genèse de votre livre – à quel moment de votre parcours le projet de l’écrire a surgi, et comment tout cela a pu prendre corps, si je puis dire.
CLAUDIA ROBERT : J’ai commencé très jeune à écrire mes douleurs au travers de poésies dont moi seule pouvais en comprendre l’origine. Ces poésies m’ont permis plus tard d’être sélectionnée au prix Arthur Rimbaud puis d’être contactée par Hachette pour l’édition d’un recueil. L’idée d’écrire mon histoire a germé à ce moment, pour dévoiler les maux que cachaient mes poésies. J’ai écrit des lignes et des lignes. Noirci je ne sais combien de cahiers… Mais je finissais toujours par les brûler de peur que quelqu’un ne les découvre.
Puis en 2005, je suis tombée par hasard sur l’annonce d’une association parisienne qui cherchait une animatrice pour mettre en place des séances d’information sur l’inceste auprès des collectivités et autres acteurs sociaux. Je suis « montée » à Paris pour les rencontrer. Ce fut magique. J’ai eu soudain l’impression de faire partie d’une famille. J’entendais des personnes raconter leurs souffrances. Elles arrivaient à en parler librement ! C’était tellement nouveau pour moi ! Cela a été comme un déclic ! Je voulais à mon tour hurler tous les mots, mettre mes années de douleurs sur la table. Ça m’a donné la rage contre tous ceux qui d’une manière ou d’une autre étaient responsables de mes souffrances. Ceux qui avaient abusé de moi mais aussi ceux qui ne m’avaient pas protégée. Ceux qui n’avaient rien voulu entendre.
Après avoir suivi une formation, j’ai ouvert un groupe de parole à Gaillac, pour permettre aux victimes de libérer leurs mots comme j’avais pu le faire moi-même. J’ai rencontré des personnes formidables. Au travers de ces groupes, nous nous sommes raconté nos vies, nos tourments, nos blessures. Cela faisait un bien fou, même si les souvenirs étaient sans cesse ravivés.
C’est à ce moment-là que j’ai pris connaissance de la prescription : il était trop tard pour porter plainte. Cela m’a révoltée ! Moi qui étais enfin prête à dévoiler l’horreur que j’avais vécue : clash, on m’imposait une fois de plus le silence ! J’étais là avec mes mots hurlant dans ma tête, et aussi avec le témoignage de toutes ces personnes qui participaient à mon groupe de parole… J’ai fini par me dire que ce n’était pas possible ! Qu’il fallait que les gens sachent. Qu’ils comprennent l’impact psychologique de l’inceste. L’inceste, c’est un meurtre. Un assassinat intérieur. Invisible et sans cadavre. On ne peut pas laisser toutes ces personnes dans cette souffrance. Dans cette non-reconnaissance.
En premier lieu, ce que l’on attend d’abord en tant que victime, c’est l’écoute. Parce que nul n’a jamais voulu entendre. Sans cette écoute, une partie de soi reste écorchée et isolée du monde : même si en apparence, on mène une vie sociale normale, à l’intérieur, il reste toujours ce que j’appelle le « cadavre » – celui de l’enfant qui n’a pas grandi. Tant que ce « cadavre » demeure en soi, les blessures restent à vif et elles vous rongent chaque jour. En silence. C’est encore plus perfide. Parce que vous ne pouvez pas en parler. L’inceste, c’est comme la rouille. Si on ne prend pas soin des victimes, les blessures deviennent corrosives et fragilisent toute la structure de l’être humain, aussi bien physique que psychologique.
Je crois que c’est à ce moment que j’ai compris que je devais raconter mon histoire. Pour moi. Pour les victimes. Pour apporter ma petite contribution à la lutte contre la prescription de l’inceste.
M. R. : Vous évoquez de façon très juste la question de la définition du viol à proprement parler, à savoir que les abus sexuels semblent être considérés comme moins graves lorsqu’il n’y a pas eu pénétration, au moyen du pénis, dans le vagin ou l’anus. Pourriez-vous nous expliquer votre ressenti par rapport à cela ?
C. R. : Je suis contente que vous abordiez le sujet car cette problématique est si peu traitée… En matière de viol, encore trop de personnes sont persuadées qu’il implique la pénétration d’un sexe dans un autre sexe. Or le viol, c’est tout acte de pénétration non consenti, quel que soit le moyen utilisé : pénétrer de force avec un doigt constitue un viol, tout autant que contraindre à la fellation ! Alors quand certaines personnes demandent : « Est-ce qu’il t’a pénétrée… avec son sexe ? », j’aimerais qu’elles prennent conscience de la violence de leur question. La présence de ce petit complément scabreux implique la condamnation à venir car vous savez que ce « détail » définira le niveau de victimisation auquel vous aurez droit. Le regard interrogateur de votre interlocuteur posé sur vous, attendant votre réponse, devient lourd. Très lourd. Toute réponse négative amène sur son visage une sorte d’expression de soulagement, alors qu’une réponse positive suscite un rictus horrifié. L’image d’un doigt enfoncé dans le sexe d’une petite fille serait-elle moins choquante que celle d’un pénis s’y introduisant ? Il semblerait que oui… Pourtant, en quoi une pénétration avec un, deux, voire trois doigts est-elle différente d’une pénétration avec une verge ?
Ces questions/réactions sont blessantes et d’une violence extrême. Elles obligent implicitement les victimes à minimiser l’impact des faits sous prétexte qu’elles n’ont pas été violées par un sexe mais par des doigts, des objets. Comme si d’un seul coup, finalement, le méchant n’était pas si méchant que cela. D’ailleurs, vous finissez même par vous demander si ce n’est pas vous la méchante lorsque vous parlez de viol. Pourtant, c’est et ça reste un viol ! Quel que soit le moyen utilisé, cela reste un corps étranger dans votre chair. Au nom de quoi le moyen de pénétration devrait-il créer des « degrés » dans la souffrance ? La douleur psychologique est la même.
M. R. : Selon vous, quelle destruction supplémentaire, à la fois sur le plan physique et psychologique, entraîne le fait que les violences sexuelles soient commises par un membre de la famille ?
C. R. : L’inceste est une trahison commise par ceux qui sont censés vous apporter amour et protection. La famille doit en principe être un lieu où puiser un sentiment de sécurité ainsi que les bases de la socialisation. Quelles peuvent être ces bases si la structure familiale est défaillante ? Quel sentiment de sécurité peut-on développer alors que c’est au sein même du noyau familial que le danger réside ?
Tous les repères deviennent erronés et la construction individuelle s’en trouve extrêmement fragilisée. Le sentiment de peur envahit tout et devient seul maître à bord. Peur de ne pas être aimée. Peur d’échouer. Peur d’être seule. Une frayeur viscérale aux inévitables répercussions sur la vie d’adulte en devenir – laquelle portera la teinte et la marque de la carence affective. Manque de confiance, dépendance affective, recherche de la perfection, etc. Autant de pathologies qui développent une anxiété permanente souvent liée à une tendance à la suractivité (obsession de toujours en faire plus pour exister aux yeux de l’autre). Un comportement épuisant à terme… physiquement comme psychologiquement.
M. R. : Le titre de votre ouvrage comporte les mots « survivre » et « renaître ». Pour vous, il est donc possible d’aspirer au bonheur après cet anéantissement qu’implique l’inceste. Pourriez-vous nous indiquer quelques points forts de votre reconstruction ?
C. R. : Survivre ne m’a jamais semblé insurmontable car pour moi il s’agissait d’une sorte d’espace temps en suspension. Comme vivre en surface. En apparence. On tente de mettre en cage ses souvenirs et on avance avec un cadavre à l’intérieur de soi. Certains parlent de « déni » mais pour moi ce n’était pas le cas. C’était juste un temps durant lequel j’ai tenté de maintenir les souvenirs à distance.
Et puis un jour, tout cela devient impossible. On se réveille un matin, fatiguée. Épuisée par le silence qui pèse sur la vie. Épuisée de porter le fardeau. Ne reste alors plus que l’ultime choix entre vivre ou mourir. Pour moi, l’instinct maternel a été le plus fort. Grâce à lui, j’ai trouvé le courage de me battre. J’ai pris conscience que je devais « renaître de mes cendres ». J’ai commencé par reprendre mes études. Passer mon BAC puis mon BTS. Ensuite je me suis inscrite à l’université. Je me souviens de mes larmes lorsque j’ai eu ma carte d’étudiante en main. Moi, la petite Claudia, inscrite à l’université ! Ce fut le début d’un long parcours de renaissance. J’ai commencé à bâtir mon identité, ma personnalité, en tant que moi, Claudia, survivante de l’inceste.
L’autre point fort de ma reconstruction a été l’animation de groupes de parole. Un véritable déclic ! Ces moments de partages m’ont été essentiels. Venir en aide aux autres, leur tendre la main, c’est quelque chose de très fort et qui m’a aidée en retour. On existe pour quelqu’un et on y gagne l’estime de soi. C’est primordial pour se reconstruire…
Photos : ©HélèneRoustan.
Derrière la porte – L’inceste, survivre et renaître, Claudia Robert, Lierre & Coudrier Éditeur (Collection Témoins), 13 euros.